
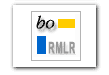
| Sommaire BO courant | Archives BO | Table des matières cumulée BO | Sommaire RMLR |
![]()
Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel des 8, 12, 15, 22, 26, 29 octobre et 2 novembre 1998 (Assemblée nationale – Sénat).
Question :
Situation de la recherche en France
Le 5 mars 1998, M. Philippe Darniche appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur un article de presse, paru en mars 1998 dans le mensuel Sciences et Avenir, intitulé "La recherche française est malade (p. 67). Il aborde avec beaucoup d’acuité le problème, récemment relayé par les médias écrits et télévisuels, de la fuite des cerveaux français et des quelque quatre cents scientifiques français qui, chaque année, s’installent aux États-Unis, faute d’avoir trouvé un emploi dans notre pays ou d’avoir été suffisamment soutenus dans leurs recherches par leur hiérarchie administrative. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître : 1o son avis personnel sur ce sujet, qui conditionne notre potentiel de recherche actuel mais surtout à venir; 2o les mesures concrètes qu’il entend prendre pour favoriser durablement l’épanouissement personnel de nos chercheurs, connus ou moins connus; 3o les moyens budgétaires qu’il entend dégager pour favoriser une recherche scientifique et universitaire de qualité confrontée en permanence à la concurrence des laboratoires internationaux.
Réponse :
Le chiffre de "quatre cents scientifiques français installés aux
États-Unis paraît très exagéré. Selon une étude sur ce sujet, du bureau du CNRS à
Washington et de la mission scientifique et technique de l’ambassade de France
(novembre 1997), trois cents français, titulaires d’un doctorat auraient
bénéficié d’un visa permanent aux États-Unis entre 1985 et 1995 (soit
sur une durée de dix ans). L’enquête portant sur le contingent 1996-1997 de jeunes
docteurs expatriés montre que la plus grande partie bénéficie d’un visa à durée
limitée, correspondant à la formation post-doctorale qu’ils suivent dans ce pays.
Il s’agit donc essentiellement d’une mobilité temporaire dans le but
d’études complémentaires. Il convient aussi de préciser qu’une partie de la
population étudiée correspond à de jeunes ingénieurs qui ne se destinent
d’ordinaire pas aux carrières scientifiques. Par ailleurs, il doit être souligné
que la mobilité des post-doctorants et la constitution éventuelle d’une communauté
de scientifiques français aux États-Unis peuvent avoir des effets stimulants sur le
potentiel français de recherche. Les pouvoirs publics devront savoir capter ces
éléments et promouvoir leur retour en France. De son côté, le gouvernement français
ne reste pas inactif: sa volonté de procurer des débouchés aux jeunes docteurs
s’est concrétisée en loi de finances 1998 par la création de 600 emplois, dont
400 emplois de chercheurs, dans les établissements publics à caractère
scientifique et technologique (EPST). Parallèlement, les universités ont bénéficié de
1800 créations d’emplois d’enseignants-chercheurs. Cet effort se poursuit en
loi de finances 1999 avec la création d’une centaine de chercheurs et 1500
recrutements supplémentaires d’enseignants-chercheurs. En outre, un développement
de procédures visant à inciter les entreprises à embaucher des docteurs dans le cadre
d’une opération expérimentale a été lancé en 1997; un budget de 14 millions
de francs a ainsi été dégagé dans le cadre du fonds de la recherche technologique. Ce
fonds a pour mission essentielle le soutien à la recherche technologique menée par les
entreprises industrielles, en liaison avec les laboratoires publics. Le soutien
prioritaire de l’emploi scientifique se traduit aussi, dans la loi de finances pour
1998, par un dispositif nouveau, financé à hauteur de 50 millions de francs,
destiné à favoriser l’insertion des post-doctorants dans les entreprises et à
développer des débouchés dans les universités et les établissements publics de
recherche. Cette mesure, reconduite en 1999, vient renforcer des initiatives comme les
"doctoriales qui proposent des formations afin d’améliorer la connaissance des
futurs docteurs sur les entreprises et les pratiques industrielles ou encore, les séjours
post-doctoraux en entreprise qui ont pour objectif d’aider les entreprises innovantes
à recruter de jeunes docteurs pour mener à bien un projet en liaison avec un laboratoire
externe à l’entreprise. En privilégiant la relance de l’emploi scientifique,
le Gouvernement entend renforcer la capacité des organismes publics de recherche et des
entreprises en France à offrir des emplois aux jeunes docteurs et assurer ainsi le
renouvellement des talents et le développement du niveau d’excellence de la
communauté scientifique nationale.
(Sénat – JO du 08-10-1998, pp. 3179-3180)
Question :
Fonctionnaires et agents publics
(mutations – rapprochement des conjoints)
Le 6 juillet 1998, M. Rudy Salles attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur les termes du 10e alinéa du préambule de la constitution de 1946, lequel stipule : "La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. En vertu de ce principe, le Conseil constitutionnel a censuré certaines dispositions de la loi du 24 août 1993, considérant le droit pour les étrangers, comme pour les nationaux de "mener une vie familiale normale. Sur la même base, les étrangers résidant en France obtiennent, de fait, en fort peu de temps, le droit au regroupement familial. Considérant ces attendus, il s’étonne que le même traitement ne soit pas garanti aux fonctionnaires français. En effet, certains d’entre eux doivent parfois attendre plus de trois ans pour bénéficier du rapprochement de conjoint, ce qui oblige nombre de familles à vivre des situations très difficiles de par la responsabilité de l’État. Au nom des principes constitutionnels précités, il lui demande donc quelles dispositions le Gouvernement entend prendre, et dans quels délais, afin de mettre un terme définitif à ces situations.
Réponse :
Les articles 60 et 62 de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État permettent aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des
raisons professionnelles de bénéficier, dans toute la mesure compatible avec le bon
fonctionnement du service, d’une mutation prioritaire ou, si les possibilités de
mutation sont insuffisantes, d’un détachement ou d’une mise à disposition
auprès d’une autre administration. Ce même dispositif existe dans la fonction
publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Dans ce cadre, chaque
administration ou collectivité gestionnaire est chargée de mettre en place, en
concertation avec les représentants du personnel, les critères permettant de mettre en
œuvre les mutations prioritaires. Afin de départager les fonctionnaires qui
pourraient bénéficier d’une telle mutation, les critères d’ancienneté et de
notation peuvent intervenir dans un second temps. Le caractère prioritaire attaché à la
mutation des fonctionnaires séparés de leurs conjoints ne crée toutefois pas un droit
absolu et immédiat à obtenir la mutation de leur choix. En effet, le mouvement de
mutation est fonction des emplois vacants. Par ailleurs, toutes les demandes ne peuvent
être immédiatement satisfaites en raison de leur forte concentration géographique; il
est inévitable qu’apparaisse un certain blocage entre les vœux exprimés par
les agents et les possibilités de mutation offertes par l’administration. Soucieux
des conséquences douloureuses que génèrent l’éloignement d’un membre de la
famille, et l’absence, dans certains cas, de perspectives rapides de rapprochement,
le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la
décentralisation a engagé une réflexion sur la mise en place d’une politique
favorisant la mobilité des fonctionnaires dans les trois fonctions publiques et entre
elles.
(Assemblée nationale – JO du 12-10-1998, p. 5594)
Question :
Fonctionnaires et agents publics
(supplément familial de traitement – conditions d’attribution)
Le 27 juillet 1998, M. André Godin appelle l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur les conditions de versement du supplément familial de traitement. La loi no 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que "le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’un seul droit par enfant. Le titre Ier du code précité et plus particulièrement l’article R.512-2, modifié par le décret no 97-1245 du 29 décembre 1997, prévoit le bénéfice des prestations familiales jusqu’au dix-neuvième anniversaire des enfants à charge dont la rémunération ne dépasse pas 55% du SMIC. Par ailleurs, la loi de finances 1998 a prévu une mise sous condition de ressources des allocations familiales, qui cessent d’être versées en cas de dépassement du plafond prévu. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser si le supplément familial de traitement doit être versé dans les mêmes conditions que les prestations familiales, tant en ce qui concerne les conditions d’ouverture du droit (âge et rémunération des enfants à charge) qu’en matière de conditions de ressources des parents (plafonds de ressources).
Réponse :
L’article 20 de la loi no 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires stipule que les
fonctionnaires ont droit après service fait à une rémunération comprenant divers
éléments dont le supplément familial de traitement. Les prestations familiales
obligatoires s’ajoutent à cette rémunération. L’article 20 précise en
outre les conditions d’ouverture du droit au supplément familial de traitement et
renvoie au titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale pour
la définition de la charge de l’enfant. De fait, la réglementation en vigueur pour
la définition des conditions d’ouverture du droit aux prestations familiales est
applicable au supplément familial de traitement, tant en ce qui concerne les dates
d’ouverture et de modification du droit au supplément familial de traitement (cf.
circulaire FP/no 1497-2A/158 du 23 décembre 1982) qu’en ce qui
concerne les limites d’âge des enfants. Aussi, la modification apportée à
l’article R.512-2 du code de la sécurité sociale, par le décret no 97-1245
du 29 décembre 1997, a-t-elle été automatiquement transposée à la
réglementation en vigueur pour le supplément familial de traitement. Une instruction de
la direction de la comptabilité publique a d’ailleurs été diffusée en ce sens à
tous les comptables publics en janvier 1998. Par contre, la circonstance que la loi
de finances pour 1998 a mis les allocations familiales sous condition de ressources
n’est d’aucun effet sur la réglementation du supplément familial de
traitement. En effet, celui-ci est lui-même, conformément à l’article 20 de
la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, un élément de la rémunération du
fonctionnaire et ne saurait à ce titre être mis sous condition de ressources.
(Assemblée nationale – JO du 12-10-1998, p. 5594)
Question :
Revalorisation des retraites dans la fonction publique
Le 20 août 1998, M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation de lui préciser la nature des mesures énoncées en faveur de la revalorisation des retraites et du pouvoir d’achat des cadres de la fonction publique.
Réponse :
L’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de
retraite prévoit que, "en cas de réforme statutaire, l’indice de traitement
mentionné à l’article L.15 sera fixé conformément à un tableau
d’assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme. En
vertu de ce principe, la situation des retraités de la fonction publique évolue en
fonction des mesures statutaires intervenues au profit des fonctionnaires de leurs corps
d’origine. La plupart des améliorations apportées à la carrière des agents en
activité, notamment depuis 1990, ont donc eu une incidence favorable sur les retraites.
Les retraités bénéficient également de l’ensemble des mesures générales prises
dans le cadre de l’accord salarial du 10 février dernier : revalorisation
de la valeur du point de 2,6% sur deux ans et augmentation de deux à six points
d’indice majoré pour les retraites les plus modestes. Dans ce contexte, le pouvoir
d’achat moyen des retraités devrait se maintenir à un niveau comparable à celui
des actifs. Pour les cadres supérieurs retraités de la fonction publique, il convient de
rappeler que la légère érosion des retraites consécutives à l’évolution des
cotisations nécessaires au maintien du système de protection sociale a été compensée
en tout ou partie, au cours de l’année 1998, par une progression de la valeur du
point (+ 1,3%) plus importante que celle des prix (+ 0,8%).
(Sénat – JO du 15-10-1998, p. 3268)
Question :
Limogeage du directeur des Archives de France
Le 10 septembre 1998, M. Serge Mathieu s’étonne auprès de Mme le ministre de la culture et de la communication du "limogeage du directeur des Archives de France, nommé en 1994. Celui-ci a appris, en écoutant France Culture, par l’absence de réponse, le désaveu de son action culturelle. Aussi lui demande-t-il si elle peut préciser à la représentation nationale dans quelles conditions s’est effectué ce désaveu et les perspectives de son action ministérielle à l’égard des Archives de France.
Réponse :
Le terme de "limogeage employé à propos de la manière dont le
directeur des Archives de France nommé en 1994 a été amené à quitter ses fonctions
est tout à fait inapproprié, dans la mesure où l’intéressé, qui n’avait
fait l’objet d’aucun désaveu, a été amené à présenter sa démission au
gouvernement, qui n’a donc aucun commentaire à formuler sur ce départ. Pour ce qui
concerne les perspectives d’avenir, il est indiqué à l’honorable parlementaire
que le ministère de la culture et de la communication conçoit pour le service public des
archives une ambition forte, cohérente avec le rôle fondamental que ce service public
joue dans la conservation du patrimoine national, dans la perpétuation de la mémoire
administrative, politique et sociale et dans la connaissance historique. Cette ambition se
matérialise par la préparation d’un projet de loi modernisant la législation
française sur les archives et par la mise au point d’un programme de modernisation
des archives nationales, destiné à permettre à ces dernières de remplir leurs missions
dans les meilleures conditions. Sur ce dernier point, il était prévu, jusqu’à
présent, que la Maison de la Mémoire de la Ve République accueillerait à Reims
les archives publiques postérieures à 1958, mais il paraît aujourd’hui nécessaire
de globaliser la réflexion à l’ensemble des sites des archives nationales,
d’où la mission de réflexion confiée au nouveau directeur des Archives de France
qui doit remettre ses premières propositions avant la fin du mois d’octobre.
Parallèlement, le travail entrepris avec les différentes administrations pour améliorer
la collecte des archives ainsi qu’avec les collectivités territoriales et, en
particulier, les départements de qui dépendent les services des archives
départementales, sera poursuivi. De même, le travail sur l’utilisation des
technologies de l’information sera accéléré afin de rendre les archives
accessibles au plus grand nombre, dans le respect du droit applicable. Il s’agit donc
au total, d’une volonté particulièrement affirmée de redonner toute sa vigueur à
un secteur que sa vocation situe au cœur même du pacte républicain.
(Sénat – JO du 22-10-1998, pp. 3339-3340)
Question :
Contrôle des fichiers informatiques
et du traitement des données personnelles au niveau international
Le 2 avril 1998, M. Emmanuel Hamel attire l’attention de M. le Premier ministre sur le rapport d’un ancien président de section du Conseil d’État intitulé "Données personnelles et société de l’information qui lui a été remis le 3 mars dernier dans lequel son auteur estime que le contrôle et le traitement des fichiers informatiques et des données personnelles ne peut se cantonner au niveau national ni européen. "Les flux d’informations traversent constamment les frontières et ont de plus en plus un caractère planétaire. Tous les contrôles, toutes les réglementations peuvent être contournés ou détournés dans le cadre de réseaux comme Internet. Un dialogue intercontinental doit s’ouvrir pour y remédier, au-delà des différences de conception et de civilisation. Il lui demande quelle est sa réaction face à cette constatation d’une incontestable vérité et quelles vont en être les conséquences. –
Réponse :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à
l’honorable parlementaire que les réseaux de communication planétaires tels
qu’Internet représentent un double défi du point de vue des réglementations
nationales encadrant le traitement des données à caractère personnel. D’une part,
les multiples points d’entrée et de stockage de l’information qu’ils
présentent sont susceptibles de compromettre l’effectivité et l’efficacité de
l’application des règles de droit, compte tenu des difficultés à localiser et à
identifier les auteurs d’atteintes aux droits des personnes et à faire exécuter les
mesures de justice. D’autre part, la diversité des systèmes juridiques mondiaux
soulève tout à la fois des problèmes multiples de désignation de la loi nationale
applicable et d’hétérogénéité des protections dont fait l’objet la vie
privée, les unes étant fondées, à l’instar des systèmes prévalant en Europe,
sur l’intervention du législateur et le rôle d’autorités de contrôle
indépendantes et les autres faisant appel à des mécanismes d’autorégulation
assortis de sanctions privées. Dans ces conditions, la nécessité d’un dialogue
intercontinental, soulignée par M. Guy Braibant dans le rapport qu’il a remis
au Premier ministre le 3 mars dernier, revêt de toute évidence un caractère
fondamental et divers travaux de réflexion, actuellement en cours, dans des enceintes
telles que le Conseil de l’Europe, l’OCDE et l’organisation mondiale du
commerce, illustrent la très grande opportunité d’une telle démarche. Toutefois,
une condition de l’efficacité de celle-ci réside dans la possibilité pour
l’Union européenne d’apparaître comme un pôle suffisamment unifié autour des
exigences de protection des données à caractère personnel que partagent
aujourd’hui ses États membres et qui servent à ceux-ci de référence commune dans
leurs rapports avec les pays tiers. À cet égard la directive du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données revêt une
importance toute particulière dans la mesure où ce texte, dont la France opérera très
prochainement la transposition, comporte des dispositions précises encadrant les flux
transfrontières de données entre l’Union européenne et les États non membres de
celle-ci.
(Sénat – JO du 22-10-1998, p. 3366)
Question :
Apparition d’Internet et révision
de la loi informatique et liberté
Le 16 avril 1998, M. Georges Gruillot demande à M. le Premier ministre de lui préciser si, compte tenu de l’évolution du secteur de l’informatique avec notamment l’apparition d’Internet, il envisage de reconsidérer les dispositions de la loi informatique et libertés de 1978 et d’étendre les compétences de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL).
Réponse :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à
l’honorable parlementaire que la Chancellerie prépare pour l’automne prochain
un projet de loi conduisant à d’importantes modifications de la loi du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce
texte répond tout à la fois à l’obligation qu’a la France d’intégrer
dans son droit la directive communautaire du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et à des impératifs
d’adaptation de la loi susvisée du 6 janvier 1978 à la généralisation des
utilisations de la micro-informatique ainsi qu’à l’accroissement des échanges
transfrontières de données dans le cadre des réseaux de communication tels
qu’Internet. Le projet gouvernemental qui s’inspirera largement des propositions
formulées dans un rapport remis au Premier ministre le 3 mars dernier par
M. Guy Braibant comportera notamment un volet de dispositions destinées à renforcer
substantiellement les prérogatives que possède la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) dans le contrôle a posteriori des traitements
de données à caractère personnel.
(Sénat – JO du 22-10-1998, p. 3367)
Question :
Marchés publics
(appels d’offres – jury – audition des candidats – légalité)
Le 10 août 1998, M. Bernard Seux attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur les conséquences du décret no 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services. Ce décret précise qu’en matière de concours avec remise de prestations les candidatures sont transmises de matière anonyme au jury qui les analyse, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d’appréciation indiqués dans l’avis d’appel public à la concurrence. Traditionnellement, le règlement de la consultation prévoit une audition des candidats, au vu notamment des caractéristiques du programme ou du niveau des prestations demandées permettant au jury de compléter l’avis précédemment émis. Il demande à M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de bien vouloir préciser si l’audition des candidats peut être maintenue dans le règlement de la consultation au regard du décret précité qui impose que les travaux d’analyse et de vérification soient effectués sur des projets anonymes.
Réponse :
Les dispositions de l’article 279-1 du code des marchés
publics introduites par le décret no 98-111 du 27 février 1998
transposant la directive 92/50 du 18 juin 1992 portant coordination des procédures
de passation des marchés publics de services s’appliquent à ce jour, sans
préjudice des prescriptions particulières non contraires, aux deux procédures de
concours prévues au titre Ier du livre III du code des marchés
publics, c’est-à-dire l’appel d’offres avec concours (art. 302) et le
concours de maîtrise d’œuvre (art. 314 ter). Or aux termes de
l’article 279-1 l’avis du jury doit être rendu sur la base de prestations
transmises de manière anonyme, ce qui exclut l’audition des candidats par le jury.
Le choix du maître d’ouvrage se fait alors de manière souveraine, au vu de
l’avis du jury. Une circulaire interministérielle est en préparation pour préciser
les modalités pratiques d’application de ces règles.
(Assemblée nationale – JO du 26-10-1998, p. 5867)
Question :
Emploi (contrats emploi solidarité –
cumul avec une activité professionnelle complémentaire –
loi no 97-940 du 16 octobre 1997 – décrets d’application
–
publication)
Le 26 janvier 1998, M. Bernard Perrut appelle l’attention de Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité sur certaines mesures prévues dans la loi du 16 octobre 1997 relative à l’emploi des jeunes. En particulier l’article 4 précise que les titulaires d’un contrat emploi solidarité (CES) peuvent être autorisés à exercer une activité professionnelle en complément, dans des conditions fixées par décret, et pour une durée limitée. À sa connaissance, ce décret n’a pas été publié au Journal officiel. Il lui demande dans quel délai elle prévoit la publication de ce décret.
Réponse :
Le contrat emploi solidarité est destiné aux personnes rencontrant de
grandes difficultés d’insertion qui ne sont pas susceptibles d’occuper un
emploi ou une formation professionnelle qualifiante. Sa durée hebdomadaire maximale est
de vingt heures. La répartition entre mi-temps travaillé et mi-temps non travaillé doit
permettre aux salariés de préparer leur insertion dans l’emploi en participant à
des actions de formation, des modules de soutien à la recherche d’emploi et en
recherchant un autre emploi... Afin d’assurer la mise en place de tels parcours, la
possibilité du cumul d’un CES et d’une autre activité rémunérée a
d’abord été écartée. L’article 4 de la loi no 97-940 du
16 octobre 1997 a ouvert la possibilité de cumuler un contrat emploi solidarité
avec une activité salariée. La loi d’orientation relative à la lutte contre les
exclusions du 29 juillet 1998 précise les conditions d’application du cumul et
a supprimé le renvoi au décret d’application prévu par l’article 4 de la
loi précitée. Le cumul est donc permis depuis la promulgation de la loi de lutte contre
les exclusions dans les conditions suivantes: il peut s’exercer à l’issue du
troisième mois de contrat emploi solidarité, et pendant douze mois; l’activité
complémentaire est inscrite dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel
dont la durée ne peut excéder un mi-temps : le nombre d’heures de travail
cumulées du salarié ne doit pas excéder la durée légale du temps de travail;
l’activité complémentaire ne peut s’effectuer dans le cadre d’un autre
contrat emploi solidarité, d’un contrat emploi-consolidé ou d’un contrat
conclu dans le cadre du programme "nouveaux services, nouveaux emplois; elle ne peut
s’exercer auprès de l’employeur de CES, ni d’un service de l’État,
d’une collectivité territoriale, d’un établissement public administratif ou
d’un groupement d’intérêt public. En revanche, elle s’exerce auprès des
employeurs du secteur privé affiliés au régime général d’assurance chômage ou
de certains employeurs du secteur public (établissements publics à caractère industriel
et commercial, sociétés d’économie mixte...). Au regard des bénéficiaires de
contrat emploi solidarité, cette réforme poursuit deux objectifs : améliorer leur
situation financière et sociale et augmenter leurs chances de s’insérer à
l’issue de leur CES. Ils pourront ainsi préparer leur insertion dans le secteur
marchand en développant leur réseau de connaissances, en enrichissant leur expérience
professionnelle, en s’intégrant dans le monde du travail.
(Assemblée nationale – JO du 26-10-1998, p. 5885)
Question :
Fonctionnaires et agents publics
(contractuels et vacataires – statistiques)
Le 20 juillet 1998, M. Jean-Marie Demange appelle l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur le nombre de personnes employées à durée déterminée. Il lui demande de bien vouloir lui préciser, par catégorie d’emploi, le nombre de personnes employées comme contractuelles et vacataires dans chacune des fonctions publiques.
Réponse :
La loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires pose le principe selon lequel les emplois permanents de
l’État, des régions, des communes et de leurs établissements publics à caractère
administratif sont occupés par des fonctionnaires. À titre dérogatoire et par
disposition législative, l’emploi de non-titulaires peut être autorisé. Dans le
cas général, les contrats conclus dans le cadre des lois du 11 juin 1983 (fonction
publique de l’État), du 26 janvier 1984 (fonction publique territoriale) et du
9 janvier 1986 (fonction publique hospitalière) sont à durée déterminée.
Cependant, le recrutement de non-titulaires sur contrat à durée indéterminée peut
être autorisé: dans la fonction publique de l’État pour le recrutement
d’agents non titulaires assurant des fonctions correspondant à un besoin permanent
impliquant un temps incomplet (art. 6 du décret no 86-83 du
17 janvier 1986); dans certains établissements publics à caractère administratif
ou dans certaines institutions spécialisées de l’État inscrits sur une liste
fixée par décret au Conseil d’État; dans la fonction publique hospitalière pour
recruter des agents non titulaires exerçant des fonctions pour lesquelles il
n’existe pas de corps de fonctionnaires ou bien des fonctions impliquant un service
à temps incomplet d’une durée égale ou inférieure au mi-temps. En dehors de ces
cas précis, les non-titulaires qui bénéficient de contrats à durée indéterminée ont
été recrutés antérieurement à ces lois. La répartition des contractuels entre ceux
à durée déterminée et ceux à durée indéterminée est une donnée de gestion
relevant de la responsabilité des directeurs de personnel des différents ministères ou
des responsables des ressources humaines des collectivités territoriales ou des
hôpitaux. Cette information n’est pas centralisée par le ministère chargé de la
fonction publique. Les notions de contractuels et de vacataires correspondent à des
définitions de nature différente. La situation de contractuel correspond à une
qualification juridique de l’emploi de non-titulaire. La notion de vacataire, pour sa
part, correspond, objectivement, à une définition comptable du support budgétaire de la
rémunération (crédits de vacations et non pas emploi budgétaire) et subjectivement, à
la nature provisoire, ponctuelle ou de renfort des tâches accomplies. Le recensement des
agents titulaires : la population des non-titulaires est constituée de
sous-ensembles très différents les uns des autres. Ces agents peuvent être
caractérisés selon des critères variables : nature des tâches accomplies, durée
d’emploi, acte juridique d’engagement, support budgétaire, base de la
rémunération, régime d’assurance vieillesse... C’est pourquoi une approche
statistique globale de l’ensemble des non-titulaires est nécessaire.
En ce qui concerne les services de l’État, l’exploitation des fichiers de paie
par l’INSEE permet de classer les non-titulaires recensés dans les ministères
civils en différentes catégories. Il s’agit ici d’une ventilation d’ordre
statistique et non pas juridique. Les derniers chiffres disponibles portent sur
l’année 1996 où 200193 non-titulaires étaient enregistrés (au 31 décembre).
La source statistique utilisée résultant de l’exploitation de données nécessaires
à la paie des agents et non pas d’une exploitation de données de gestion, la
ventilation des 33 597 contractuels entre ceux sur contrats à durée indéterminée
(essentiellement les plus anciens) et ceux sur contrats à durée déterminée n’est
pas disponible. La catégorie des "non-titulaires sur crédits divers comprend
35 881 personnes (dont 6 300 personnes affectées à des tâches de nettoyage).
C’est vraisemblablement dans cette rubrique que se trouvent la plupart des personnes
qualifiées de l’appellation extrêmement vague de "vacataires. La catégorie
des "non-titulaires sur crédits de rémunérations principales comprend 29 360
personnes. Elle est constituée de non-titulaires tantôt rémunérés sur emplois
budgétaires (personnels "à statut spécifique de l’équipement, par exemple),
tantôt sur crédits de vacations. Ces agents présentent des caractéristiques
d’emploi régulier et de durée d’emploi, souvent égale ou supérieure au
mi-temps. Les 79 859 auxiliaires sont généralement rémunérés sur des emplois
budgétaires de titulaires ou de contractuels. Ils se partagent en 5 586
"auxiliaires administratifs et 74273 "auxiliaires enseignants, y compris les
maîtres d’internat et surveillants d’externat (MISE) des lycées et collèges.
Hors MISE, les auxiliaires d’enseignement représentent environ 35 000 agents
(enseignement scolaire, enseignement supérieur, agriculture essentiellement). Les
6 440 recrutés locaux sont pour 70% d’entre eux des étrangers recrutés par
les services représentant la France à l’étranger et soumis aux dispositions du
droit local. Les 30% restants sont recrutés dans les territoires d’outre-mer. Enfin,
13 200 ouvriers d’État environ et moins de 2000 militaires non titulaires sont
recensés dans les ministères civils.
(Assemblée nationale – JO du 26-10-1998, pp. 5914-5915)
Question :
Fonctionnaires et agents publics
(cessation progressive d’activité – remplacement – procédure)
Le 21 septembre 1998, Mme Paulette Guinchard-Kunstler attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur le remplacement des fonctionnaires qui travaillent à mi-temps dans les dernières années de leur carrière avant le départ à la retraite. Il semble qu’un compagnonnage sur deux ou trois ans permettrait à leur successeur un apprentissage progressif et une intégration souple dans le service. Ce dispositif permettrait de renforcer le potentiel technique et, bien sûr, de trouver une solution qui garantisse l’emploi dans le cadre d’un statut élargi. Elle lui demande par conséquent si des dispositions sont actuellement en cours ou en préparation pour mieux adapter la fonction publique à ces évolutions au service de l’emploi.
Réponse :
La loi no 93-121 du 27 janvier 1993 a pérennisé
le dispositif de la cessation progressive d’activité qui permet aux agents de la
fonction publique âgés d’au moins cinquante-cinq ans et ayant accompli vingt-cinq
années de services de travailler à mi-temps jusqu’à l’âge de soixante ans,
avec un revenu de remplacement égal à 50% de leur rémunération totale
d’activité, auquel s’ajoute une indemnité exceptionnelle de 30% du traitement
indiciaire à temps plein. Ce dispositif permet d’opérer des recrutements à hauteur
des quotités de temps de travail libérées. Les administrations ont d’ores et
déjà la possibilité de confier aux agents expérimentés en cessation progressive
d’activité le soin de contribuer à la formation des agents nouvellement recrutés.
(Assemblée nationale – JO du 26-10-1998, p. 5917)
Question :
Informatique
(Microsoft – droit de la concurrence – respect)
Le 6 juillet 1998, M. Olivier de Chazeaux appelle l’attention de M. le secrétaire d’État à l’industrie sur la nature des relations entretenues entre l’État français et la société Microsoft. Dans sa réponse à la question no 13430 du 27 avril 1998 parue au Journal officiel, Assemblée nationale du 22 juin 1998, page 3459, M. le secrétaire d’État lui a en effet répondu que "l’attention des pouvoirs publics porte sur la question des capacités du marché national à établir des relations économiques dans des conditions satisfaisantes avec la société Microsoft et que, à cet égard, "il importe de veiller à ce que n’existe aucun obstacle au libre choix des utilisateurs publics et privés. Compte tenu du caractère général de la réponse de M. le secrétaire d’État, il lui demande de bien vouloir lui préciser quels liens l’État entretient avec la société Microsoft et de lui indiquer en conséquence la manière dont l’administration veille à assurer la liberté de choix des utilisateurs.
Réponse :
L’État entretient avec les industriels français et étrangers du
secteur des technologies de l’information et de la communication des relations de
suivi et de dialogue. Les rapports existant avec la société Microsoft entrent dans ce
cadre et ne présentent pas de caractère particulier. L’État a donné récemment
son accord de principe à la mise en place par Thomson Multimédia de partenariats
industriels stratégiques, notamment avec la société Microsoft, à la suite d’une
large consultation d’acteurs industriels conduite par cette entreprise. La commission
des participations et des transferts sera saisie du projet d’entrée des partenaires
industriels dans le capital de la société. Pour ce qui concerne la liberté de choix, il
existe des alternatives à l’offre logicielle de la société Microsoft. Par
ailleurs, les utilisateurs peuvent faire appel en tant que de besoin au droit de la
concurrence. L’État demeurera attentif aux informations ou plaintes que des
entreprises pourraient communiquer éventuellement sur des contraintes anormales
auxquelles elles seraient soumises et qui constitueraient des entraves à la concurrence.
(Assemblée nationale – JO du 26-10-1998, pp. 5918-5919)
Question :
Télécommunications
(recherche – financement)
Le 7 septembre 1998, M. Olivier de Chazeaux appelle l’attention de M. le secrétaire d’État à l’industrie sur la situation de la recherche dans le secteur des télécommunications et plus particulièrement sur celle du Réseau national de recherche en télécommunications (RNRT). Il lui demande de définir les orientations de la politique gouvernementale en la matière et plus particulièrement de lui indiquer si les crédits alloués au RNRT ne sont pas manifestement insuffisants au regard des enjeux d’un tel secteur.
Réponse :
Pour répondre à l’évolution du secteur des télécommunications
et conforter le potentiel scientifique et technique français en télécommunications, le
Gouvernement a mis en place, en décembre 1997, le Réseau national de recherche en
télécommunications (RNRT). Le RNRT instaure une communauté de laboratoires de recherche
en télécommunications (privés et publics), pilotée par un comité d’orientation
représentant les principaux acteurs de la recherche en télécommunications, et
travaillant autour de projets coopératifs soutenus par les pouvoirs publics. Le budget
prévu pour soutenir les projets coopératifs dans le cadre du RNRT est de
260 millions de francs pour la première année et devrait être reconduit pour 1999.
Ce budget est réparti de la manière suivante: 210 millions de francs d’aide
sont prévus pour contribuer aux projets labellisés coopératifs regroupant laboratoires
publics, laboratoires industriels et PME. 150 millions de francs sont prévus pour
les projets précompétitifs, et 60 millions de francs pour les projets
exploratoires; 50 millions de francs sont prévus pour soutenir des projets portés
par une PME, dans le cadre des procédures d’instruction de l’ANVAR. Un premier
appel à projets a été lancé le 20 avril dernier. Dans un premier temps,
105 projets ont été déposés auprès du RNRT et à l’issue de leur examen, le
comité d’orientation a décidé d’en labelliser 29 dont 16 concernant des
thèmes de recherche précompétitifs et 13 des thèmes de recherche exploratoires. Le
secrétaire d’État à l’industrie et le ministère de l’éducation
nationale, de la recherche et de la technologie poursuivent l’instruction
administrative des dossiers labellisés en vue d’un soutien financier public. Cet
appel à projets s’est poursuivi et une deuxième vague de projets était attendue
pour le 21 septembre. Ces nouveaux projets sont actuellement en cours d’examen
par des comités d’experts. Par ailleurs, l’ANVAR vient de lancer un appel à
projets spécifique pour les PME. Les financements accordés dans le cadre du RNRT ne sont
que des financements partiels des projets. À ce budget viennent s’ajouter la
contribution des laboratoires publics sous forme de salaires, et la contribution des
entreprises. Aussi, le montant total des budgets mobilisés par le RNRT et qui seront
finalement utilisés pour financer la recherche amont en télécommunications en France
est bien supérieur aux crédits qui lui sont directement affectés.
(Assemblée nationale – JO du 26-10-1998, p. 5920)
Question :
Réflexion sur les règles de fonctionnement
des institutions européennes de normalisation
Le 3 septembre 1998, M. Emmanuel Hamel attire l’attention de M. le secrétaire d’État à l’industrie sur la proposition faite à la page I-38 de l’avis du Conseil économique et social sur le rapport intitulé "Le rôle des brevets et des normes dans l’innovation et l’emploi et adopté lors de la séance du 27 mai 1998 de cette même assemblée d’engager une réflexion sur "les règles de fonctionnement des institutions de normalisation. Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et si le Gouvernement envisage d’inciter ses partenaires européens à engager une telle réflexion.
Réponse :
La place de la normalisation européenne vis-à-vis de la normalisation
tant américaine que japonaise et son influence sur la normalisation internationale sont
parmi les enjeux majeurs auxquels elle est aujourd’hui confrontée. Le rôle des
normes dans les échanges internationaux est croissant. Facteurs de protectionnisme
lorsqu’elles divergent d’un État à l’autre, leur harmonisation,
préconisée par l’Union européenne et l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), est à l’inverse un outil puissant d’ouverture des marchés. C’est
pourquoi la France participe activement au processus de normalisation européen et
international. D’un point de vue institutionnel, elle est représentée par
l’Association française de normalisation (AFNOR) au sein du Comité européen de
normalisation (CEN) et de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et
l’Union technique de l’électricité (UTE) participe aux travaux du Comité
européen de normalisation dans le domaine électrotechnique (CENELEC) et de la Commission
électronique internationale (CEI). De leur côté, les entreprises envoient de nombreux
experts dans les groupes de travail de ces organismes qui élaborent les normes. En effet,
il leur appartient de se mobiliser pour élaborer les normes. Une norme n’est jamais
neutre : elle traduit les politiques industrielles et les technologies de ceux qui
l’élaborent. Aussi, chacun doit être présent dans les travaux de normalisation
pour défendre et faire prendre en compte ses intérêts. Dans ce contexte, il est clair,
comme le souligne le Conseil économique et social, que les multinationales américaines
et japonaises implantées en Europe ne cachent plus leur stratégie d’influence et de
contrôle sur la normalisation européenne. Cela étant, le système actuel, qui confie à
des délégations nationales le soin de représenter les industriels dans les instances
européennes de normalisation et soumet les projets de normes au vote des membres,
protège largement les intérêts des entreprises françaises. Une question revient
régulièrement. Elle touche à l’évolution de ces règles et à l’abandon
proposé des représentations nationales. Si une telle évolution devait survenir, elle
pourrait dans une certaine mesure contribuer à un affaiblissement du poids des intérêts
nationaux au profit des groupes les plus puissants. Elle n’est évidemment pas
souhaitable. C’est pourquoi l’organisation actuelle du système répond au mieux
aux préoccupations du Conseil économique et social, étant entendu qu’il convient
d’œuvrer sans relâche à son amélioration, tout en préservant nos intérêts.
(Sénat – JO du 29-10-1998, p. 3469)
Question :
Patrimoine culturel
(musée des arts premiers – création – conséquences –
musée de l’Homme)
Le 17 novembre 1997, M. Georges Sarre attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l’avenir du musée de l’Homme et le projet de musée de "l’Homme, des Arts et des Civilisations, dit musée des "Arts premiers. Le ministre a en effet rappelé dans une récente déclaration que le musée de "l’Homme, des Arts et des Civilisations serait réalisé sans rien imposer au musée de l’Homme, un comité scientifique devant "avoir pour tâche de définir la mission du futur musée. Il lui rappelle que le musée de l’Homme devait, selon les conclusions du rapport (daté d’août 1996) de la commission "Arts premiers présidée par M. Jacques Friedmann, faire l’objet d’un démantèlement ainsi donc que le Muséum national d’histoire naturelle, remettant profondément en cause les missions de ces institutions en tant qu’établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Au regard des conséquences de ce projet sur le musée de l’Homme et le Muséum national d’histoire naturelle, il lui demande quelles sont, à l’heure actuelle, les modalités envisagées par le Gouvernement tant pour la réalisation, au minimum, du programme de rénovation du musée de l’Homme que pour l’aménagement d’un futur musée des "Arts premiers. Il insiste sur la nécessité d’opérer une claire distinction entre ces deux projets de nature très différente. Il précise, en effet, que le musée de l’Homme est un musée-laboratoire, dont les collections ont été constituées depuis plus d’un siècle dans le cadre de missions et travaux scientifiques et qu’elles constituent, à ce titre, un ensemble cohérent exceptionnel qu’on ne saurait démanteler pour constituer un musée d’Art et de Civilisations. Il attend enfin de lui de plus amples informations sur la composition du comité scientifique auquel il a fait référence.
Question :
Patrimoine culturel
(musée des arts premiers – création)
Le 27 juillet 1998, M. Georges Sarre attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la mise en place indispensable d’une structure fédérale permanente réunissant en son sein les différentes institutions concernées par le futur musée des Arts et des Civilisations, en particulier le musée de l’Homme et le Muséum national d’histoire naturelle dont une partie des collections exceptionnelles devrait servir à la constitution de l’ensemble des pièces qui seront exposées dans ce nouveau musée. La création de cet établissement offre en effet l’opportunité unique de constituer un grand pole fédérateur consacré plus spécifiquement à l’anthropologie culturelle et à l’ethnologie au sein duquel pourraient se développer des activités d’enseignement et de recherche, mais aussi de diffusion des connaissances en direction d’un large public, et qui pourrait être lié par exemple au CNRS, à l’École des hautes études en sciences sociales et à certaines universités. Cette structure fédérale pourrait prendre la forme juridique d’un groupement d’intérêt public (GIP) selon les dispositions prévues par l’article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation de la recherche et du développement technologique de la France (modifiée par la loi no 93-1 du 4 janvier 1993, article 8). Il rappelle en effet que le cadre juridique du GIP est particulièrement approprié aux actions de coopération entre les établissements publics de recherche et entre ceux-ci et toute personne morale de droit public ou privé. Le GIP permet notamment aux différents partenaires de mettre en commun des moyens afin de poursuivre des objectifs et d’exercer des activités d’intérêt commun définis lors de sa création que les partenaires ne pourraient mener à bien seuls, ainsi que de gérer des équipements nécessaires à ces activités. La mise en place d’un GIP permettrait donc d’éviter un isolement préjudiciable des institutions en question et de favoriser en plus d’une synergie, l’interdisciplinarité. Cette structure pourrait avoir par exemple pour compétence : la gestion des collections des institutions muséographiques concernées afin d’éviter leur démembrement et d’un centre de documentation commun, l’édition de produits d’information, la programmation d’expositions ou de manifestations impliquant des partenaires extérieurs, la coordination et le suivi de projets de recherche. Ce sont les raisons pour lesquelles il souhaiterait connaître ses projets concernant la création de ce groupement d’intérêt public, et à quelle date celui-ci pourrait être mis en place. Il rappelle la nécessité de prendre dès que possible, dans le cadre de ces projets, des mesures en faveur d’un programme de rénovation du musée de l’Homme qui devrait préluder à celui du Muséum national d’Histoire naturelle dont l’état de certains bâtiments implique de façon urgente, pour protéger du risque de destruction des collections uniques au monde, des travaux de mise aux normes.
Réponse :
Il existe, depuis le 21 février 1997, une mission de
préfiguration chargée de "favoriser la création, à Paris, d’un
établissement culturel ouvert au public et consacré aux arts premiers. En
février 1998, un conseil restreint tenu à Matignon a décidé de constituer une
nouvelle structure juridique destinée à prendre la suite de la mission de préfiguration
pour faire entrer le projet de musée dans une phase opérationnelle. L’opportunité
de constituer un groupement d’intérêt public a été longuement examinée.
Plusieurs éléments plaidaient en faveur de cette formule notamment le fait qu’elle
permet aisément d’associer les représentants du Muséum national d’histoire
naturelle ainsi que ceux du musée de l’Homme. Cependant, les délais de constitution
d’un GIP sont apparus comme excessifs, en raison de la nécessité de déterminer
(sauf à constituer un GIP sans capital) les modalités de participation respective des
membres (art. 21 de la loi no 82-61 du 15 juillet 1982). Cela aurait
impliqué, en ce qui concerne le muséum, de réaliser l’inventaire des collections
à transférer au futur musée avant de pouvoir constituer le GIP et, en ce qui concerne
l’État, d’approuver un plan de financement prévisionnel, lequel ne peut être
élaboré avant que les études de préfiguration n’aient progressé. Finalement, le
Gouvernement a souhaité avancer dans la voie d’un établissement public national à
caractère administratif, placé sous la tutelle conjointe des ministres de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de la culture. Cette forme juridique a
été employée avec succès pour d’autres établissements culturels. Elle offre les
garanties indispensables de transparence des processus de décision, de rigueur dans
l’utilisation des fonds publics et d’adaptation à la complexité particulière
de l’opération. Cet établissement devra jouer un rôle fédérateur et favoriser
tout à la fois la diffusion des connaissances vers le public et le développement
d’activités d’enseignement et de recherche. Le projet d’EPA va dans ce
sens : il est prévu d’associer dans le cadre du conseil d’orientation le
Muséum national d’histoire naturelle, le musée des arts africains et océaniens,
l’EHESS et le CNRS notamment. Les missions qu’il est prévu de confier à
l’EPA devraient lui permettre d’éditer des produits d’information, de
programmer des expositions ou des manifestations impliquant des partenaires extérieurs,
de coordonner et de suivre des projets de recherche. Enfin, concernant la nécessité de
rénover le Muséum national d’histoire naturelle, il est à noter qu’un audit
concernant l’ampleur et le phasage des travaux à engager a été mené.
(Assemblée nationale – JO du 02-11-1998, p. 6024)
Question :
Syndicats
(fonctionnaires et agents publics – représentativité – réglementation –
application)
Le 17 août 1998, M. André Aschieri attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les difficultés que rencontre la Fédération syndicale unitaire (FSU) à voir prise en compte la représentativité que lui accordent par leur vote les fonctionnaires. Alors qu’un arrêt du Conseil d’État de février 1996 portant sur la composition du conseil économique et social reconnaît que la FSU "constitue l’une des organisations professionnelles de salariés les plus représentatives cette organisation n’est toujours pas représentée dans cet organisme pas plus que dans les comités économiques et sociaux régionaux, en dépit de demandes répétées auprès des gouvernements successifs. De plus, l’actuelle composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (CSFPE) ne reflète pas la représentativité acquise par les différentes organisations syndicales dans les élections. Il lui demande ce qu’il compte faire pour traduire dans les institutions légales la représentativité réelle de ce syndicat.
Réponse :
La question de la représentation de la Fédération syndicale unitaire
(FSU) au sein de ces organismes est un problème complexe et qui ne relève pas des
attributions du ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la
technologie. La composition de ces organismes est en effet fixée par des décrets qui ne
relèvent pas de la compétence directe du ministère de l’éducation nationale, de
la recherche et de la technologie. Ainsi, les organisations syndicales représentées au
Conseil économique et social sont désignées dans l’article 2 du décret no 84-558
du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil
économique et social. La décision de modifier ce décret afin de permettre une
représentation de la FSU appartient ici au Premier ministre. Les organisations syndicales
représentées aux Comités économiques et sociaux régionaux sont désignées dans le
décret no 82-866 du 11 octobre 1982 (art. 2 et 4), modifié par le
décret no 9-307 du 12 mai 1989. Le décret du 11 octobre 1982
est un décret en Conseil d’État pris sur le rapport du ministre de
l’intérieur, dont les services sont seuls compétents pour prendre en charge une
modification. La composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État
(CSFPE) est fixée par le décret no 82-450 du 28 mai 1982, modifié
par le décret no 84-611 du 16 juillet 1984. La décision de modifier
ce décret appartient au Premier ministre.
(Assemblée nationale – JO du 02-11-1998, p. 6025)