
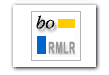
| Sommaire BO courant | Archives BO | Table des matières cumulée BO | Sommaire RMLR |
![]()
Vocabulaire des sciences et techniques spatiales : liste de termes, expressions et définitions adoptés
Commission générale de terminologie et de néologie - NOR : CTNX0104712K - JO du 18-04-2001, pp. TED 42020-42034
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Correction d'orbite consistant à réduire l'altitude moyenne d'un satellite artificiel.
Voir aussi : déclin d'orbite, relèvement d'orbite, rétrécissement d'orbite.
Équivalent étranger : orbit lowering.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules spatiaux.
Définition : Élément en saillie de la structure principale d'un véhicule spatial.
Note : Des panneaux solaires déployables, un bras télémanipulateur, une antenne extérieure sont des appendices.
Équivalent étranger : appendage.
Domaine : Sciences et techniques spatiales.
Définition : Firme industrielle responsable des études d'ensemble, ainsi que de la cohérence et du suivi des développements d'un grand système spatial, tel qu'un lanceur ou une station spatiale.
Équivalent étranger : industrial architect.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Construction mécanique.
Définition : Partie de la structure d'un engin spatial qui transmet la poussée du moteur-fusée à l'ensemble.
Équivalent étranger : thrust frame, thrust structure.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules spatiaux.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules aérospatiaux.
Définition : Masse maximale de charge utile pouvant être ramenée au sol par un véhicule spatial.
Équivalent étranger : maximum download.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mesures.
Définition : Capteur réalisant des mesures qui font partie de l'objet de la mission d'un engin spatial.
Équivalent étranger : mission sensor.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mesures.
Définition : Capteur destiné à fournir des informations sur l'état d'un engin spatial.
Équivalent étranger : housekeeping sensor, engineering sensor.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Infrastructure orbitale.
Définition : Station placée en orbite terrestre et qui transmet au sol, sous forme d'un faisceau de rayonnement, l'énergie obtenue par conversion de l'énergie solaire.
Équivalent étranger : solar space power plant (SSPP).
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Essais.
Définition : Appareil dont la rotation permet de soumettre un corps à une accélération pendant une durée voulue, et qui est en particulier utilisé pour la sélection et l'entraînement des pilotes et des spationautes ou pour des essais d'équipements spatiaux.
Équivalent étranger : centrifuge.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Manœuvre destinée à rendre circulaire l'orbite d'un satellite par action sur sa vitesse, le plus souvent à l'apogée ou au périgée.
Équivalent étranger : orbit circularization.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Essais.
Définition : Petite centrifugeuse de laboratoire utilisée pour soumettre des organismes vivants à des conditions de pesanteur particulières.
Équivalent étranger : clinostat.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules aérospatiaux.
Définition : Partie d'un véhicule spatial où se trouvent groupés les moteurs et certains organes de pilotage.
Note : On rencontre aussi le terme « baie de propulsion », qui n'est pas recommandé.
Équivalent étranger : engine bay, motor bay, propulsion bay.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules spatiaux.
Définition : Ensemble de satellites remplissant des fonctions identiques, répartis de façon à assurer, en permanence, une mission commune.
Note : Une constellation peut être constituée de nombreux satellites à défilement en orbite basse ou moyenne, pour assurer par exemple des missions de télécommunication ou de radionavigation.
Équivalent étranger : satellite constellation.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules aérospatiaux.
Définition : Ensemble des techniques passives et actives permettant de maintenir les différentes parties d'un engin spatial dans des gammes spécifiées de température.
Note : Dans le cas de techniques actives, on utilise aussi le terme « régulation thermique ».
Équivalent étranger : thermal control.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Pour une tuyère orientable, valeur maximale du déplacement angulaire de son axe par rapport à un angle de braquage nul.
Équivalent étranger : nozzle-steering capability.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Diminution progressive de l'altitude moyenne d'un satellite artificiel, due aux forces de freinage naturelles résultant par exemple du rayonnement cosmique ou du frottement atmosphérique.
Voir aussi : abaissement d'orbite, rétrécissement d'orbite.
Équivalent étranger : orbit decay, orbital decay.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Variation lente et monotone des paramètres caractérisant une orbite.
Note : La dérive d'orbite peut résulter soit d'une action volontaire, soit de l'effet de forces naturelles se superposant à l'attraction du corps principal considéré comme ponctuel, entraînant une déformation de l'orbite képlérienne.
Équivalent étranger : orbit drift.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique du vol-Propulsion.
Définition : Écart qu'un défaut de construction introduit entre le centre de masse d'un véhicule aérospatial et le point d'application de la résultante des forces de poussée, créant un couple perturbateur qui tend à modifier l'orientation du véhicule.
Équivalent étranger : thrust misalignment.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules spatiaux.
Définition : Opération réalisée dans l'espace et destinée à séparer mécaniquement deux engins spatiaux précédemment rendus solidaires par amarrage.
Note : L'antonyme de « désamarrage » est « amarrage ».
Équivalent étranger : undocking.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Diminution de la vitesse d'écoulement au col d'une tuyère, au-dessous de la vitesse sonique caractéristique du régime de fonctionnement stable normalement utilisé, entraînant une réduction de la poussée.
Équivalent étranger : unpriming.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Cloison percée d'un orifice calibré et placée dans une canalisation pour en modifier les conditions d'écoulement.
Équivalent étranger : diaphragm.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Partie d'une tuyère de section croissante, en aval du col, où se produit la détente du gaz.
Note : Dans le divergent d'une tuyère à blocage sonique, la vitesse du gaz croît au-delà de la vitesse du son au col.
Équivalent étranger : divergent, divergent exit cone, divergent nozzle section, divergent section, nozzle extent.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Séparation angulaire entre deux satellites vus du centre de la Terre et situés sur la même orbite terrestre.
Note : Dans le cas de satellites géostationnaires, l'écart orbital est la différence de leurs longitudes.
Voir aussi : position orbitale.
Équivalent étranger : orbital spacing.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique des structures.
Définition : Phénomène oscillatoire longitudinal instable qui peut se produire dans les étages à ergols liquides d'un lanceur lorsque des fluctuations de poussée du moteur engendrent des vibrations de structure et des colonnes liquides qui se répercutent sur l'alimentation du moteur.
1. L'effet « pogo », s'il n'est pas maîtrisé, est susceptible de provoquer des dysfonctionnements pouvant aller jusqu'à la destruction du lanceur.
2. Le mot « pogo » vient de l'expression « pogo stick » qui désigne un jouet d'enfant constitué d'une échasse montée sur un ressort.
Équivalent étranger : pogo effect.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Partie d'un moteur à ergols liquides, constituée de la chambre de combustion, de ses injecteurs et de la tuyère.
Équivalent étranger : ejector.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Structure principale d'un propulseur à poudre contenant le propergol.
Équivalent étranger : case, casing.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion-Moyens de lancement.
Définition : Ergol que l'on produit, stocke et utilise à des températures inférieures à 120 kelvins.
1. L'hydrogène liquide et l'oxygène liquide sont des ergols cryotechniques.
2. Le terme « ergol cryogénique » est à éviter dans ce sens.
Équivalent étranger : cryogenic rocket propellant.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Ergol généralement cryotechnique dont une partie à l'état solide et l'autre à l'état liquide sont intimement mélangées.
Note : L'expression « névasse d'ergol » est utilisée par les Canadiens.
Voir aussi : ergol cryotechnique.
Équivalent étranger : slush propellant.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion-Moyens de lancement.
Définition : Ergol dont les propriétés physico-chimiques permettent le transport et la conservation sans dispositions exceptionnelles.
Note : L'hydrazine et le péroxyde d'azote sont des ergols stockables.
Voir aussi : ergol cryotechnique.
Équivalent étranger : storable propellant.
Domaine : Sciences et techniques spatiales.
Définition : Désigne, par convention, la région de l'Univers située au-delà de la partie de l'atmosphère terrestre où la densité de l'air permet la sustentation des aéronefs.
Note : La limite inférieure de l'espace extra-atmosphérique ne peut être associée à une altitude précise ; on admet généralement qu'elle se situe aux environs de 50 km. Cependant, les engins spatiaux subissent, à des altitudes bien supérieures, un freinage ou un échauffement dus à l'atmosphère.
Équivalent étranger : outer space.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Radiocommunication.
Définition : Région de l'espace extra-atmosphérique située au-delà d'une certaine distance de la Terre, fixée par convention.
Note : À la fin du vingtième siècle, cette distance a été fixée à deux millions de kilomètres. Au début des années 1970, l'espace lointain était défini comme la région de l'espace située au-delà de la distance Terre-Lune (soit environ 384 000 km).
Équivalent étranger : deep space.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules aérospatiaux.
Définition : Partie d'un véhicule aérospatial destinée à en assurer la propulsion de façon autonome et se séparant généralement à l'issue de sa phase de fonctionnement.
Note : Le terme « étage » désigne aussi les parties de dispositifs divers tels que turbopompe ou amplificateur.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Étage généralement accolé à la structure d'un lanceur, contribuant à la poussée, le plus souvent au décollage.
Voir aussi : propulseur d'appoint.
Équivalent étranger : auxiliary propulsion stage.
Domaine : Sciences et Techniques spatiales/Propulsion.
1. Dispositif combinant, en cours de détente, des jets d'origines différentes en vue d'obtenir un jet unique.
2. Dispositif fournissant un gaz sous pression obtenu par l'évaporation d'un liquide cryotechnique.
Équivalent étranger : expander.
Abréviation : extinction, n. f.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Dans un propulseur, diminution brutale de la combustion entraînant une chute significative de la poussée.
Note : Dans un propulseur à liquide, l'extinction peut se produire par épuisement de l'un au moins des ergols et la poussée cesse instantanément. Dans un propulseur à propergol solide, en fin de fonctionnement, l'extinction est suivie d'une poussée résiduelle due à une combustion des ergols résiduels.
Voir aussi : arrêt par épuisement.
Équivalent étranger : burn-out, cut-off.
Abréviation : extinction, n. f.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Radiocommunication.
Définition : Disparition, généralement momentanée, de signaux radioélectriques.
Note : Une extinction de signal se produit notamment au cours de la rentrée d'un engin spatial dans l'atmosphère, par suite de la formation autour de cet engin d'une gaine ionisée opaque aux ondes radioélectriques.
Équivalent étranger : signal black-out, black-out.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Structures.
Définition : Cloison assurant l'étanchéité entre deux réservoirs superposés.
Équivalent étranger : common bulkhead.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules aérospatiaux.
Définition : Engin propulsé par réaction et n'utilisant que des ergols embarqués, sans avoir recours au milieu ambiant.
Note :
1. La plupart des lanceurs et des missiles sont des fusées à un ou plusieurs étages.
2. Le propulseur d'une fusée est appelé moteur-fusée.
Voir aussi : lanceur, moteur-fusée, fusée-sonde.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique céleste.
Définition : Région de l'espace dans laquelle la force d'attraction d'un astre est prépondérante par rapport à la force d'attraction des autres astres.
Note : Les termes « sphère d'action » et « sphère d'influence » sont encore utilisés dans ce sens.
Équivalent étranger : gravisphere, gravitational sphere.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules aérospatiaux.
Définition : Processus visant à diriger le mouvement d'un véhicule spatial ou aérospatial en fonction de certains objectifs, en lui appliquant des corrections de trajectoires prenant en compte les résultats des corrections précédentes.
1. Les objectifs du guidage par itération peuvent consister à suivre un autre véhicule ou à atteindre une cible.
2. Le système de guidage agit par l'intermédiaire du système de pilotage.
Équivalent étranger : iterative guidance.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Instabilité de combustion caractérisée par une succession périodique d'extinctions et d'allumages avec une période de l'ordre de la seconde.
Voir aussi : instabilité de combustion.
Équivalent étranger : chuffing.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Propergol dont les ergols réagissent spontanément entre eux, sans intervention d'un allumeur.
Équivalent étranger : hypergol, hypergolic propellant.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Propulseur destiné à fournir des poussées de courte durée.
Équivalent étranger : thruster.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : La plus petite impulsion que peut produire un impulseur.
Équivalent étranger : impulse bit.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique céleste-Mécanique spatiale.
Définition : Angle formé par le plan de l'orbite d'un satellite et un plan fondamental qui, pour les satellites artificiels de la Terre, est le plan de l'équateur terrestre.
1. L'inclinaison se compte de 0 à 90° dans le cas d'une orbite directe et de 90° à 180° dans le cas d'une orbite rétrograde.
2. On utilise souvent la forme abrégée « inclinaison ».
Équivalent étranger : orbit inclination, orbital inclination.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules aérospatiaux.
Définition : Rapport de la masse sèche d'un étage de fusée à la masse maximale des ergols consommables.
Note : Cet indice est en général utilisé pour traduire les contraintes imposées au constructeur lors de la phase de conception du lanceur.
Voir aussi : indice de structure, masse sèche.
Équivalent étranger : construction ratio.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique du vol-Véhicules aérospatiaux.
Définition : Rapport de la masse sèche d'un étage de fusée à la masse totale de cet étage avant allumage.
Note : Cet indice exprime en général la performance de la structure réalisée.
Voir aussi : indice de construction, masse sèche.
Équivalent étranger : structural ratio.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Revêtement non combustible appliqué à la surface d'un bloc de propergol solide pour délimiter la surface de combustion.
Note : L'inhibiteur et la forme du bloc de propergol conditionnent l'évolution de la surface de combustion et celle de la poussée.
Équivalent étranger : inhibitor, flame inhibitor.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Dispositif introduisant sous forme pulvérisée des ergols liquides dans la chambre de combustion.
Note : Un injecteur est un dispositif, généralement complexe, qui doit assurer des conditions propices à l'homogénéisation du mélange des ergols.
Équivalent étranger : injector.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Défaut de combustion correspondant à une oscillation de pression dans la chambre de combustion.
Voir aussi : halètement, ronflement.
Équivalent étranger : combustion instability.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules aérospatiaux.
Définition : Véhicule aérospatial autopropulsé capable de placer une charge utile dans l'espace.
Note : Les lanceurs actuels sont essentiellement des fusées à plusieurs étages.
Équivalent étranger : launch vehicle, launcher, launching vehicle.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement.
Définition : Faisceau de câbles et de canalisations solidaires de la table de lancement et reliant à la base d'un lanceur des dispositifs d'alimentation, de contrôle ou de commande
Voir aussi : liaison ombilicale.
Équivalent étranger : launching table umbilical.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement.
Définition : Faisceau souple et mobile de câbles et de canalisations reliant à un équipement, à un engin spatial ou à un véhicule aérospatial, des dispositifs d'alimentation, de contrôle et de commande.
Note : Une liaison ombilicale peut relier à un lanceur des installations au sol ou relier à un engin spatial le scaphandre d'un spationaute en sortie extra-véhiculaire.
Voir aussi : liaison de culot, mât ombilical, prise ombilicale.
Équivalent étranger : umbilical cable, umbilical cord.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Revêtement peu combustible appliqué sur la paroi interne de l'enveloppe d'un propulseur à propergol solide et contribuant à la protection de cette paroi ainsi qu'à la liaison entre le bloc de propergol et l'enveloppe.
Voir aussi : inhibiteur, enveloppe.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique céleste.
Définition : Intersection du plan d'une orbite avec un plan de référence qui, pour un satellite, est généralement le plan équatorial du corps autour duquel il orbite.
Équivalent étranger : line of nodes.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Radiocommunication.
Définition : Détermination de la position d'un point fixe ou mobile, à la surface ou au voisinage de la Terre ou d'un astre, au moyen d'un ou de plusieurs satellites artificiels.
Note : La localisation par satellite s'effectue soit à distance à partir de signaux issus de ce point et reçus par des satellites, soit en ce point par traitement de signaux de repérage émis par des satellites.
Voir aussi : navigation par satellite.
Équivalent étranger : satellite positioning, satellite position finding.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Synonyme : maintien en position.
Définition : Opération récurrente visant à maintenir un satellite sur une orbite spécifiée et à ajuster l'heure de son passage en un point déterminé de cette orbite.
Note : Dans le cas d'un satellite géostationnaire, le maintien à poste se traduit par une apparence d'immobilité du satellite pour un observateur terrestre.
Équivalent étranger : station keeping.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules aérospatiaux.
Définition : Masse d'un véhicule spatial ou d'un étage de lanceur à l'exclusion des ergols et des autres matières consommables.
Équivalent étranger : dry mass.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Opérations.
Définition : Document publié par un organisme pour annoncer le calendrier des lancements qu'il prévoit et indiquer le système de transport et les charges utiles emportées.
Équivalent étranger : launch manifest.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement.
Définition : Mât érigé sur une aire de lancement, supportant des câbles et des canalisations nécessaires aux alimentations, aux systèmes de contrôle et aux commandes d'un véhicule aérospatial pendant la période qui précède le décollage.
Voir aussi : liaison ombilicale, prise ombilicale, table de lancement, tour de montage.
Équivalent étranger : umbilical mast.
Domaine : Sciences et techniques spatiales.
Définition : Ensemble des activités de la météorologie qui utilisent des systèmes spatiaux.
Équivalent étranger : space meteorology.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Pilotage-Propulsion.
Définition : Propulseur de petite taille fournissant des poussées de quelques newtons au plus.
Note : Les micropropulseurs sont utilisés notamment pour la commande d'orientation des satellites.
Voir aussi : propulsion plasmique.
Équivalent étranger : thruster, microthruster.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Propergol composé d'un seul ergol.
1. Le peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) et l'hydrazine sont des monoergols quand ils agissent par décomposition.
2. On rencontre aussi « monergol ».
Équivalent étranger : monopropellant.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules aérospatiaux.
Définition : Se dit d'un véhicule aérospatial à un seul étage.
Équivalent étranger : single stage.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Propulseur à réaction qui n'utilise pendant son fonctionnement que des ergols stockés à bord, sans avoir recours à l'oxygène atmosphérique.
Note : On utilise souvent la forme abrégée « fusée » pour les moteurs-fusées de faible poussée, par exemple dans les expressions « fusée de freinage », « fusée de séparation », « fusée de mise en rotation ».
Équivalent étranger : rocket engine, rocket motor.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Croissance de l'accélération durant la phase propulsée d'un engin spatial, résultant principalement de la diminution de masse due à la consommation du propergol.
Équivalent étranger : acceleration build-up.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Pilotage-Propulsion.
Définition : Propulseur complémentaire de faible poussée, servant à ajuster la poussée appliquée à un engin spatial.
1. Le moteur vernier peut être utilisé après l'arrêt du système de propulsion principal.
2. Vernier, du nom du mathématicien Pierre Vernier, désigne à l'origine un dispositif permettant d'affiner la lecture d'un instrument de mesure.
Équivalent étranger : vernier motor, vernier engine.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules aérospatiaux
Définition : Se dit d'un véhicule aérospatial à plusieurs étages.
Équivalent étranger : multistage.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Navigation.
Définition : Navigation utilisant des satellites pour déterminer la position et la vitesse d'un mobile à la surface de la Terre ou dans l'atmosphère terrestre.
Voir aussi : radionavigation par satellite.
Équivalent étranger : satellite navigation.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Navigation.
Définition : Conduite d'un véhicule spatial à sa destination par la détermination de la position du véhicule, le choix de sa trajectoire et le guidage par référence à cette trajectoire.
Voir aussi : guidage, spationautique.
Équivalent étranger : space navigation.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Navigation.
Définition : Navigation utilisant des astres d'apparence ponctuelle comme repères.
Note : Dans l'espace, la navigation stellaire fait généralement appel à des suiveurs stellaires.
Voir aussi : suiveur stellaire.
Équivalent étranger : celestial navigation, astronavigation.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique céleste.
Définition : L'un des points d'intersection d'une orbite avec le plan de référence qui, pour un satellite, est généralement le plan équatorial du corps autour duquel il orbite.
Note :
1. L'un des nœuds est appelé nœud ascendant, l'autre est appelé descendant.
2. Par convention, si le plan fondamental est le plan équatorial du corps principal, le nœud ascendant est le point où le satellite traverse ce plan du sud vers le nord.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules spatiaux.
Définition : Objet introduit par l'homme dans l'espace extra-atmosphérique.
Voir aussi : engin spatial, débris spatial.
Équivalent étranger : space object.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Opérations.
Définition : Organisme ou entreprise qui assure un service de lancement d'engins spatiaux.
Équivalent étranger : launch operator.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Orbite d'un satellite de la Terre dont l'altitude à l'apogée, faible par rapport à celle des satellites géostationnaires, se situe, selon les domaines d'application, entre quelques centaines et quelques milliers de kilomètres.
Voir aussi : orbite géostationnaire, orbite moyenne.
Équivalent étranger : low Earth orbit (LEO), low orbit.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Orbite héliosynchrone d'un satellite artificiel dont tous les passages à un nœud se font pendant le lever ou le coucher du Soleil, observés au point du sol qui est à la verticale de ce nœud.
Note : L'orbite crépusculaire permet l'observation de la Terre avec des effets d'ombre particuliers, liés à l'incidence rasante.
Équivalent étranger : dawn orbit, dusk orbit.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Orbite proche de l'orbite des satellites géostationnaires, qui en diffère principalement par la période de révolution et qui est utilisée pour déplacer en longitude un satellite géostationnaire, soit lors de la mise à poste, soit lors d'un changement de poste.
Équivalent étranger : drift orbit.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique céleste-Mécanique spatiale.
Définition : Orbite parcourue par un satellite lorsque la projection de ce satellite sur le plan équatorial du corps principal tourne dans le même sens que la rotation de ce dernier autour de son axe.
Note : L'antonyme du terme « orbite directe » est « orbite rétrograde ».
Équivalent étranger : direct orbit.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique céleste-Mécanique spatiale.
Définition : Trajectoire d'un corps qui évolue, sous l'action des forces de gravitation, non pas autour d'un astre mais au voisinage d'un point de Lagrange.
Note : Les points de Lagrange, au nombre de cinq, sont des points de l'espace où le potentiel gravitationnel créé par un ensemble de deux astres atteint localement un maximum ou un minimum.
Équivalent étranger : halo orbit.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique céleste.
Définition : Orbite située dans le plan de l'équateur du corps principal ou, en pratique, au voisinage de ce plan.
Voir aussi : orbite géostationnaire.
Équivalent étranger : equatorial orbit.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Orbite des satellites géostationnaires, unique, équatoriale, circulaire et directe, et située à une altitude d'environ 35 800 km.
Voir aussi : satellite géostationnaire, satellite géosynchrone.
Équivalent étranger : geostationary satellite orbit (GSO), geostationary Earth orbit (GEO).
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Orbite d'un satellite de la Terre dont chaque passage dans le même sens à une latitude donnée s'effectue tout au long de l'année à la même heure solaire vraie.
Note : Le nœud ascendant d'une orbite héliosynchrone dérive dans le sens direct de 360o par an dans le plan équatorial. L'orbite doit être quasi polaire (inclinaison de l'ordre de 98° pour une altitude comprise entre 600 km et 800 km).
Voir aussi : orbite crépusculaire, orbite midi-minuit, satellite héliosynchrone.
Équivalent étranger : heliosynchronous orbit, sun-synchronous orbit.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Synonyme : orbite non perturbée.
Définition : Orbite d'un corps en interaction gravitationnelle avec un seul autre corps, chaque corps étant assimilé à un point.
1. L'orbite képlérienne de chaque corps est une orbite conique dont l'un des foyers coïncide avec le centre de masse de l'autre corps pris comme origine du référentiel.
2. En première approximation, les planètes du système solaire et les satellites artificiels de la Terre décrivent des orbites képlériennes elliptiques ou circulaires.
Équivalent étranger : keplerian orbit, unperturbed orbit, undisturbed orbit.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Orbite héliosynchrone d'un satellite artificiel dont tous les passages à un nœud se font vers midi ou vers minuit, en heure locale, à la verticale de ce nœud.
Équivalent étranger : noon/midnight orbit.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Orbite d'un satellite de la Terre dont l'altitude se situe au-dessus de celles des orbites basses et en dessous de celle de l'orbite géostationnaire.
Équivalent étranger : medium Earth orbit (MEO).
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Orbite qui s'écarte légèrement d'une orbite képlérienne parce que la distribution des masses des deux corps en présence n'est pas sphérique ou pas homogène ou parce qu'il existe d'autres forces dues, par exemple, à des propulseurs, à d'autres corps attractifs ou à des collisions avec les particules du milieu ambiant.
Équivalent étranger : disturbed orbit, perturbed orbit.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Orbite dont le plan fait un angle nul ou faible avec l'axe des pôles du corps principal.
Note : L'inclinaison d'une orbite polaire est voisine de 90°.
Voir aussi : satellite polaire.
Équivalent étranger : polar orbit.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique céleste-Mécanique spatiale.
Définition : Orbite parcourue par un satellite lorsque la projection de ce satellite sur le plan équatorial du corps principal tourne en sens inverse de la rotation de ce dernier autour de son axe.
Note : L'antonyme du terme « orbite rétrograde » est « orbite directe ».
Équivalent étranger : retrograde orbit.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Orbite d'un satellite artificiel dont l'apogée a une altitude très supérieure à celle du périgée.
1. Un satellite de la Terre en orbite très excentrique est visible d'une région déterminée pendant une grande partie de sa période de révolution.
2. L'expression « orbite très elliptique » est à éviter.
Équivalent étranger : highly eccentric orbit (HEO).
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique du vol.
Définition : Période du vol d'un véhicule aérospatial au cours de laquelle l'altitude et la vitesse croissent sous l'effet de la propulsion.
Équivalent étranger : powered ascent phase.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules spatiaux.
Définition : Dans un engin spatial, structure destinée à supporter une ou plusieurs charges utiles et équipée pour fournir les ressources nécessaires à leur fonctionnement.
Note : Une plate-forme peut comprendre des équipements de mesure, de commande, de gestion de bord et de servitude, et être utilisable pour différents types de missions.
Équivalent étranger : platform.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules spatiaux.
Définition : Plate-forme standard utilisable pour des missions différentes.
Note : Bus est l'abréviation du terme « omnibus », utilisé pour désigner un équipement à usage multiple.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement.
Définition : Ensemble fixe ou mobile des dispositifs assurant jusqu'au lancement le support d'un véhicule aérospatial, son maintien en position verticale et les raccordements avec les installations au sol par des liaisons ombilicales ou de culot.
Voir aussi : aire de lancement.
Équivalent étranger : launch platform, launching platform.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/équipements-Véhicules spatiaux.
Définition : Partie avant carénée d'une fusée-sonde, qui contient en général une charge utile.
Équivalent étranger : nose cone.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Équipements.
Définition : Structure intermédiaire servant à fixer des équipements sur la plateforme d'un véhicule spatial.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Longitude du plan méridien d'un satellite géostationnaire.
Note : On dit aussi « position sur orbite ».
Voir aussi : écart orbital, poste (à).
Équivalent étranger : orbital position, orbital slot.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Se dit d'un satellite dont l'orbite et l'heure de passage en un point déterminé de cette orbite sont les mieux adaptées à l'accomplissement de sa mission.
Voir aussi : maintien à poste, position orbitale.
Équivalent étranger : station.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion-Pyrotechnie.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Opérations.
Définition : Opération qui consiste à suivre le déplacement d'un objet spatial.
Note : La poursuite s'effectue en général par détermination de la position ou des composantes de la vitesse par des moyens radioélectriques ou optiques.
Voir aussi : suiveur de satellite, acquisition.
Équivalent étranger : tracking.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement.
Définition : Dispositif destiné à connecter un équipement, un engin ou un véhicule aérospatial à sa liaison ombilicale.
Note : Dans le cas d'un lanceur, la prise ombilicale est munie d'un dispositif assurant la déconnexion de la liaison ombilicale juste avant le décollage.
Voir aussi : liaison ombilicale.
Équivalent étranger : umbilical connector.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Propergol dont tous les ergols, combinés ou mélangés, se présentent et sont utilisés sous forme solide.
Voir aussi : bloc de propergol solide, propergol.
Équivalent étranger : solid propellant.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Propulseur fonctionnant au moyen d'ergols liquides ou en bouillie.
Voir aussi : ergol en bouillie.
Équivalent étranger : liquid propellant engine.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Synonyme : propulseur auxiliaire.
Définition : Propulseur qui est généralement accolé à l'extérieur de la structure principale d'un lanceur et qui contribue à la poussée, le plus souvent au décollage.
Note : Le propulseur d'appoint est souvent largué après son extinction.
Équivalent étranger : strap-on booster, auxiliary booster, booster.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Propulseur fonctionnant au moyen d'une combinaison d'au moins un ergol solide et d'au moins un ergol liquide.
Équivalent étranger : hybrid propellant motor, hybrid propellant rocket engine.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Propulsion à réaction dans laquelle l'éjection de matière résulte d'une élévation de température obtenue par des procédés électriques.
Équivalent étranger : electrothermal propulsion.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Mode de propulsion dans lequel l'énergie solaire sert à entretenir une réaction chimique produisant un agent propulsif.
Équivalent étranger : solar chemical propulsion.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Mode de propulsion dans lequel l'énergie solaire sert à porter à haute température un agent propulsif.
Équivalent étranger : solar thermal propulsion.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Synonyme : propulsion à plasma.
Définition : Mode de propulsion électrique dans lequel l'agent propulsif est un flux d'ions accéléré et canalisé par l'action combinée d'un champ électrique et d'un champ magnétique neutralisé avant d'être éjecté sous forme de plasma.
Équivalent étranger : plasma propulsion.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Navigation.
Définition : Navigation utilisant certaines propriétés de propagation des ondes radio-électriques entre un mobile et un ou plusieurs satellites pour déterminer la position et la vitesse du mobile.
Note : Les constellations de satellites GPS-NAVSTAR, GLONASS et GNSS sont des systèmes de radionavigation par satellite à couverture mondiale.
Voir aussi : navigation par satellite.
Équivalent étranger : satellite radionavigation.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Moyens de lancement.
Définition : Dispositif de lancement, fixe ou mobile, assurant au départ le support et éventuellement le maintien dans la direction voulue et le pointage initial d'un véhicule aérospatial ou d'un missile.
Note : Une rampe de lancement peut être orientable. Elle assure généralement les raccordements électriques et les échanges de fluides entre le véhicule aérospatial et les installations de lancement.
Voir aussi : plateforme de lancement.
Équivalent étranger : launch ramp, launching ramp.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Fiabilité.
Définition : Régime de fonctionnement largement en deçà des conditions limites, destiné à réduire les contraintes et augmenter ainsi la fiabilité et la durée de vie d'un matériel.
Note : On parle aussi de fonctionnement en charge réduite.
Équivalent étranger : derated-load mode, derated-load operation.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules aérospatiaux.
Voir : stabilisation d'orientation.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Correction d'orbite consistant à augmenter l'altitude moyenne d'un
Note : Le relèvement d'orbite est pratiqué en particulier pour compenser le freinage
Voir aussi : abaissement d'orbite.
Équivalent étranger : orbit raising.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique du vol.
Définition : Événement caractérisé par le passage d'un engin spatial à proximité d'un objet céleste ou d'un objet spatial.
1. Une rencontre peut aboutir à un impact ou à une satellisation ou encore servir à une assistance gravitationnelle.
2. Une rencontre organisée à vitesse relative faible ou nulle est appelée rendez-vous spatial.
Équivalent étranger : encounter.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Modification intentionnelle de l'orbite d'un satellite artificiel.
Voir aussi : relèvement d'orbite, surbaissement d'orbite, surélévation.
Équivalent étranger : re-orbiting.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Modifier l'orbite d'un satellite artificiel.
Équivalent étranger : to re-orbit.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules aérospatiaux-Propulsion.
Définition : Moteur-fusée destiné à ralentir un mobile en produisant une poussée dans le sens inverse du mouvement du mobile sur lequel il est placé.
Équivalent étranger : retrorocket.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Réduction naturelle ou volontaire de l'altitude moyenne d'un satellite artificiel.
Voir aussi : abaissement d'orbite, déclin d'orbite.
Équivalent étranger : orbital step-down.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Instabilité de combustion caractérisée par une succession périodique d'extinctions et d'allumages avec une période de l'ordre du centième de seconde.
Voir aussi : instabilité de combustion.
Équivalent étranger : chugging.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Stabilisation.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Pilotage.
Définition : Dispositif mécanique, constitué par une masse équilibrée pouvant être accélérée ou décélérée en rotation autour d'un axe, dans un sens ou dans l'autre, qui permet d'assurer la commande d'orientation fine d'un véhicule spatial par l'effet du couple d'action et de réaction créé entre la roue et le véhicule spatial.
Voir aussi : volant d'inertie.
Équivalent étranger : reaction wheel.
Domaine : Sciences et techniques spatiales.
Définition : Objet naturel ou artificiel animé d'un mouvement quasi périodique autour d'un corps de masse prépondérante, ce mouvement étant principalement déterminé par le champ de gravité de ce dernier.
Équivalent étranger : satellite.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules spatiaux.
Définition : Satellite de la Terre qui parcourt une orbite équatoriale, circulaire et directe avec une période de révolution égale à la période de rotation sidérale de la Terre, soit 23 h 56 min, et qui, de ce fait, paraît fixe à un observateur terrestre.
Note :
1. L'orbite des satellites géostationnaires est unique et son altitude est d'environ
35 800 km.
2. Le satellite géostationnaire est un cas particulier de satellite géosynchrone.
Voir aussi : satellite géosynchrone, orbite géostationnaire.
Équivalent étranger : geostationary satellite.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules spatiaux.
Définition : Satellite de la Terre dont la période de révolution sidérale moyenne est égale à la période de rotation sidérale de la Terre.
Voir aussi : satellite géostationnaire.
Équivalent étranger : geosynchronous satellite.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale-Véhicules spatiaux.
Définition : Satellite de la Terre dont chaque passage dans le même sens à une latitude donnée s'effectue tout au long de l'année à la même heure solaire vraie.
Note : Ce type de satellite, dont l'orbite est quasi polaire, généralement circulaire, et d'altitude comprise entre 600 km et 800 km, est utilisé pour l'observation de la Terre, car il permet de retrouver les mêmes conditions d'éclairage solaire à chaque passage.
Voir aussi : orbite héliosynchrone.
Équivalent étranger : sun-synchronous satellite, heliosynchronous satellite.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules spatiaux.
Définition : Satellite artificiel qui passe au-dessus des zones polaires du corps principal, son orbite étant dans un plan perpendiculaire ou quasi perpendiculaire au plan équatorial de ce corps.
Équivalent étranger : polar satellite.
satellites copositionnés (langage professionnel)
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules spatiaux.
Définition : Satellites géostationnaires situés à la même position orbitale nominale avec des tolérances fixées par la règlementation internationale.
Note : En radiocommunication, les signaux des satellites copositionnés sont reçus avec un même pointage d'antenne.
Voir aussi : écart orbital, position orbitale.
Équivalent étranger : co-located satellites.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules spatiaux.
Définition : Satellites parcourant la même orbite avec un décalage temporel déterminé.
Voir aussi : satellite synchronisé.
Équivalent étranger : phased satellites.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale-Véhicules spatiaux.
Définition : Satellite de la Terre dont la période de révolution sidérale moyenne est un sous-multiple de la période de rotation sidérale de la Terre.
Équivalent étranger : subsynchronous satellite.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale-Véhicules spatiaux.
Définition : Satellite destiné à conserver une période de révolution égale à la période d'un phénomène déterminé et qui passe à des instants spécifiés en un point déterminé de son orbite.
Voir aussi : satellites déphasés.
Équivalent étranger : synchronized satellite.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Radiocommunication.
Définition : Service de radiocommunication qui dessert par l'intermédiaire d'un ou plusieurs satellites de la Terre des stations terriennes dont certaines sont mobiles.
Équivalent étranger : mobile-satellite service (MSS).
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules spatiaux.
Définition : Engin spatial non habité qui est destiné à explorer l'espace hors de la gravisphère terrestre.
Note : Les sondes planétaires, les sondes interplanétaires et les sondes lunaires sont des sondes spatiales.
Équivalent étranger : space probe.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules spatiaux.
Définition : Membre de l'équipage d'un véhicule spatial chargé de mettre en œuvre une charge utile.
Voir aussi : spécialiste de mission.
Équivalent étranger : payload specialist.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules spatiaux.
Définition : Membre de l'équipage d'un véhicule spatial chargé de la coordination de l'ensemble des opérations liées à la mission et responsable, éventuellement, de la mise en œuvre de certaines charges utiles.
Équivalent étranger : mission specialist.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique céleste.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique céleste.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Pilotage.
Synonyme : régulation d'orientation.
Définition : Maintien de l'orientation voulue d'un engin spatial autour de son centre de masse par la mise en œuvre de couples internes ou externes à l'engin.
Voir aussi : amortissement, commande d'orientation.
Équivalent étranger : stabilization, attitude control.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement.
Définition : Installation terrestre destinée, lors des opérations de lancement, à établir des liaisons avec un engin aérospatial lorsque celui-ci est hors de portée des installations de télécommunication et de poursuite de la base de lancement.
Équivalent étranger : down-range station.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/équipement.
Définition : Appareil composé d'une part d'un capteur repérant la direction d'un satellite artificiel et d'autre part d'un dispositif d'asservissement maintenant le capteur orienté dans cette direction.
Équivalent étranger : satellite tracker.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Navigation-Guidage.
Définition : Appareil spatioporté composé d'une part d'un capteur repérant la direction d'un astre déterminé d'apparence ponctuelle et d'autre part d'un dispositif d'asservissement maintenant le capteur orienté dans cette direction.
Voir aussi : navigation stellaire.
Équivalent étranger : star tracker.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Manœuvre consistant à faire passer un satellite artificiel de son orbite initiale à une orbite d'altitude notablement inférieure, en vue de l'accomplissement d'un aspect particulier de sa mission.
Note : Le surbaissement d'orbite est utilisé notamment pour avancer la retombée du satellite ou pour accomplir une observation rapprochée à la surface du sol.
Voir aussi : abaissement d'orbite.
Équivalent étranger : sub-orbiting.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Modifier l'orbite d'un satellite artificiel en diminuant notablement son altitude.
Voir aussi : surbaissement d'orbite.
Équivalent étranger : to sub-orbit.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Synonyme : surorbitation, n. f.
Définition : Manœuvre consistant à faire passer un satellite artificiel de son orbite initiale à une orbite d'altitude notablement supérieure, en vue de l'accomplissement d'un aspect particulier de sa mission.
Note : La surélévation d'orbite est utilisée notamment en fin de vie d'un satellite pour en retarder la retombée ou pour dégager l'orbite géostationnaire.
Voir aussi : orbite géostationnaire, relèvement d'orbite.
Équivalent étranger : orbit raising.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale
Définition : Modifier l'orbite d'un satellite artificiel en augmentant notablement son altitude.
Voir aussi : surélévation d'orbite.
Équivalent étranger : to raise an orbit.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique du vol.
Définition : Passage d'un engin spatial à proximité d'un astre sans capture par ce dernier.
Voir aussi : capture, rencontre.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement.
Définition : Socle horizontal, fixe ou mobile, assurant jusqu'au lancement le support d'un véhicule aérospatial.
Voir aussi : plateforme de lancement.
Équivalent étranger : launch table, launching table.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement.
Définition : Ouvrage au sol, fixe ou mobile, permettant l'érection des étages, l'accès aux différents niveaux de travail et la protection du véhicule aérospatial contre les intempéries.
Note : La tour de montage et la plateforme de lancement sont écartées l'une de l'autre avant le lancement.
Équivalent étranger : service structure, gantry, service tower.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Mesures.
Définition : Détermination et représentation, immédiate ou différée, de la trajectoire d'un véhicule aérospatial à partir des données obtenues en cours de poursuite.
Équivalent étranger : trajectography, trajectory determination.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale.
Définition : Opération consistant à faire passer un engin spatial d'une orbite à une autre orbite coplanaire en suivant une orbite de transfert, avec une dépense d'énergie minimale, par deux impulsions fournies aux extrémités du grand axe de cette orbite de transfert.
Note : L'orbite de transfert de Hohmann est une demi-ellipse képlérienne tangente aux extrémités de son grand axe, à l'orbite de départ et à l'orbite d'arrivée.
Voir aussi : orbite de transfert.
Équivalent étranger : Hohmann transfer.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Propergol composé de trois ergols.
Équivalent étranger : tripropellant.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion.
Définition : Tuyère dont une partie du divergent se trouve à l'intérieur de la chambre de combustion de façon à réduire l'encombrement du moteur.
Équivalent étranger : integrated nozzle.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules spatiaux.
Définition : Spationef de grandes dimensions.
Équivalent étranger : spaceship, space ship.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Véhicules spatiaux.
Définition : Engin spatial, habité ou non, destiné principalement au transport d'une ou plusieurs charges utiles.
Note : Un véhicule spatial peut lui-même être la charge utile d'un autre véhicule.
Équivalent étranger : space vehicle.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Propulsion-Pilotage.
Définition : Surface matérielle de grande dimension déployée dans l'espace et qui fournit une force issue de la pression de rayonnement solaire, pour propulser un véhicule spatial.
Équivalent étranger : solar sail.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Stabilisation.
Définition : Dispositif mécanique constitué par une masse équilibrée maintenue en rotation continue autour d'un axe, utilisé soit pour stabiliser l'orientation d'un spationef par effet gyroscopique soit pour accumuler de l'énergie.
Voir aussi : roue de réaction.
Équivalent étranger : momentum wheel.
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Mécanique du vol.
Définition : Phase de vol pendant laquelle un avion suit une trajectoire parabolique permettant de simuler une chute libre dans le vide et d'obtenir un état d'impesanteur pendant un intervalle de temps de l'ordre de quelques dizaines de secondes.
Équivalent étranger : parabolic flight.
TERME ÉTRANGER |
ÉQUIVALENT FRANÇAIS (2) |
|
Sciences et techniques spatiales/Propulsion-Moyens de lancement |
||
Sciences et techniques spatiales/ Mécanique céleste-Mécanique spatiale |
||
divergent, divergent exit cone, divergent nozzle section, divergent section, nozzle extent |
||
Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement |
||
geostationary satellite orbit (GSO), geostationary Earth orbit (GEO) |
||
Sciences et techniques spatiales/Mécanique céleste-Mécanique spatiale |
||
Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement |
||
Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement |
||
Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement |
||
Sciences et techniques spatiales/équipements-Véhicules spatiaux |
||
Sciences et techniques spatiales/Mécanique céleste-Mécanique spatiale |
||
Sciences et techniques spatiales/Mécanique céleste-Mécanique spatiale |
||
Sciences et techniques spatiales/Véhicules aérospatiaux-Propulsion |
||
Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement |
||
Sciences et techniques spatiales/Propulsion-Moyens de lancement |
||
Sciences et techniques spatiales/Mécanique du vol-Véhicules aérospatiaux |
||
Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale-Véhicules spatiaux |
||
Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale-Véhicules spatiaux |
||
Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale-Véhicules spatiaux |
||
Sciences et techniques spatiales/Mécanique du vol-Propulsion |
||
Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement |
||
Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement |
||
Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement |
||
(1) Les termes français à éviter figurent en caractères italiques. (2) Les termes qui sont définis dans la liste principale figurent en caractères gras. |
||
TERME FRANÇAIS (1) |
ÉQUIVALENT ÉTRANGER (2) |
|
Sciences et techniques spatiales/Mécanique du vol-Propulsion |
||
divergent, divergent exit cone, divergent nozzle section, divergent section, nozzle extent |
||
Sciences et techniques spatiales/Propulsion-Moyens de lancement |
||
Sciences et techniques spatiales/Propulsion-Moyens de lancement |
||
Sciences et techniques spatiales/Mécanique céleste-Mécanique spatiale |
||
Sciences et techniques spatiales/Mécanique du vol-Véhicules aérospatiaux |
||
Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement |
||
Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement |
||
Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement |
||
Sciences et techniques spatiales/ Mécanique céleste-Mécanique spatiale |
||
Sciences et techniques spatiales/Mécanique céleste-Mécanique spatiale |
||
geostationary satellite orbit (GSO), geostationary Earth orbit (GEO) |
||
Sciences et techniques spatiales/Mécanique céleste-Mécanique spatiale |
||
Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement |
||
Sciences et techniques spatiales/équipements-Véhicules spatiaux |
||
Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement |
||
Sciences et techniques spatiales/Véhicules aérospatiaux-Propulsion |
||
Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale-Véhicules spatiaux |
||
Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale-Véhicules spatiaux |
||
Sciences et techniques spatiales/Mécanique spatiale-Véhicules spatiaux |
||
Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement |
||
Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement |
||
Sciences et techniques spatiales/Infrastructure-Moyens de lancement |
||
(1) Les termes qui sont définis dans la liste principale figurent en caractères gras. (2) Il s'agit d'équivalents anglais, sauf mention contraire. |
||