
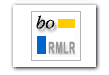
| Sommaire BO courant | Archives BO | Table des matières cumulée BO | Sommaire RMLR |
![]()
Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel des 5, 12, 16, 19, 23, 30 mars et 2 avril 1998 (Assemblée nationale – Sénat).
Question :
Mauvaise valorisation du potentiel de recherche français
Le 22 janvier 1998, M. Emmanuel Hamel attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l’information parue à la page 24 du quotidien Le Monde, du 13 décembre 1997 dernier, selon laquelle "le bon niveau de l’appareil scientifique français demeure trop peu mis en valeur par des applications technologiques. Telle est l’une des principales conclusions du quatrième rapport biennal de l’Observatoire des sciences et techniques (OTS) rendu public vendredi 12 décembre 1997". Il lui demande quelle est sa réaction face à la constatation faite par l’OTS et quelles mesures sont envisagées pour remédier à cette situation.
Réponse :
Le rapport de l’Observatoire des sciences et des techniques (OST) estime que la principale faiblesse du dispositif français de recherche et développement se situe au niveau de la valorisation des recherches. C’est une conclusion qui s’impose lorsqu’on compare l’excellence de la recherche publique en France, les progrès notables réalisés par la recherche privée, et le faible nombre d’emplois créés dans le domaine de la technologie. Le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie a donc engagé une politique volontariste en créant au sein de l’administration une nouvelle direction entièrement consacrée à la technologie. Son action portera aussi bien sur l’enseignement scolaire, sur l’enseignement supérieur et la recherche, et sur les entreprises, pour développer l’innovation et la mise en œuvre concrète de résultats scientifiques. Le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie a annoncé des mesures permettant que tous les élèves, à leur sortie du système scolaire, aient été en contact avec les technologies nouvelles de l’information. Les enseignements accorderont à l’avenir une place plus grande aux travaux expérimentaux et à l’observation. Un plan d’action largement concerté a été engagé pour rendre les formations scientifiques encore plus attractives, et développer l’emploi des docteurs notamment dans les entreprises. Ce plan prévoit que les chercheurs, pendant leur thèse, acquièrent une connaissance du monde de l’entreprise. Après l’obtention de leur diplôme, les docteurs pourront bénéficier d’un nouveau fonds de capital-risque pour créer leur propre entreprise. Le dispositif des aides à l’embauche sera complété pour favoriser l’embauche de docteurs, sur une durée indéterminée ou dans le cadre d’un projet "post-doctoral". En outre, un projet de loi sera prochainement déposé, pour favoriser l’essaimage de la recherche publique. Cette loi donnera un cadre juridique nouveau aux relations entre un chercheur et une entreprise valorisant des travaux de recherche. Enfin, l’ensemble des aides du Fonds de la recherche et de la technologie (FRT) sera réexaminé, dans une optique de soutien aux projets présentant une prise de risque de la part des entreprises. À ce titre, le FRT a vocation à intervenir davantage en faveur de petites entreprises de technologie. Il encouragera ainsi l’essaimage des grands groupes, et l’émergence de partenariats entre grands groupes, organismes de recherche et PMI. Le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie attend de ces différentes mesures des résultats rapides, dès 1998, car du développement technologique dépendent directement de nombreuses créations d’emplois et des changements profonds dans notre société.
(JO du 05-03-1998)
Question :
Bilan de l’application de la loi
sur l’utilisation de la langue française
Le 5 février 1998, M. Georges Gruillot appelle l’attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur l’application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 sur l’utilisation de la langue française. Il lui demande de lui préciser le bilan de l’application et de lui indiquer, notamment à la faveur d’exemples, les effets de ce texte sur le langage quotidien. À la lueur de ces informations, il souhaite savoir si, le cas échéant, le Gouvernement se propose de compléter le dispositif législatif actuel.
Réponse :
La loi du 4 août 1994 sur l’emploi de la langue française, qui a repris et élargi celle de 1975, est l’instrument dont disposent les pouvoirs publics pour assurer la présence du français dans les domaines où il est indispensable pour nos concitoyens. Cette loi n’exclut pas, bien entendu, que s’ajoutent au français des versions en langue étrangère, et elle comporte des dispositions en faveur de l’usage d’au moins deux langues étrangères, en plus du français, dans certains cas, pour la communication des services publics. Il convient de rappeler, en outre, que ce texte ne comporte aucune obligation d’emploi d’une terminologie particulière pour les personnes privées et les services audiovisuels. Un rapport sur l’application de cette loi est remis chaque année au Parlement, le 15 septembre. Il rassemble des informations issues de tous les ministères et organismes directement concernés par la politique en faveur du français sur notre territoire. En effet, la loi du 4 août regroupe une série de dispositions qui visent des situations diverses : informations du consommateur, protection du salarié, audiovisuel, manifestations et revues scientifiques, enseignement. Certaines sont extrêmement précises et assorties de sanctions, d’autres en sont dépourvues et ont un caractère très général, plusieurs enfin ne concernent que les services publics. Il en découle des actions très diversifiées de contrôle, de sensibilisation, d’accompagnement, et des remontées d’information inégales. Les obligations liées à l’information du consommateur font l’objet d’un excellent suivi. L’autocontrôle des entreprises se développe, et nombre d’entre elles n’hésitent plus, après vérification des marchandises, à réexpédier celles qui ne respectent pas la loi, ou à prendre les mesures nécessaires pour les mettre en conformité. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), principale administration chargée du suivi, a augmenté de 326 % ses contrôles depuis 1994 et instauré des enquêtes spécifiques consacrées aux secteurs sensibles : restauration rapide, cosmétiques et produits d’hygiène pour le corps, location de véhicule sans chauffeur, etc. Une coopération s’est établie entre la DGCCRF et d’autres administrations habilitées à rechercher et poursuivre les infractions (direction générale des impôts, direction générale des douanes et des droits indirects). Le nombre de procès-verbaux transmis aux parquets par la DGCCRF est passé de 107 en 1994 à 366 en 1996. 32 condamnations ont été prononcées en 1995, 56 en 1996, 27 de janvier à avril 1997. Les juges, en outre, ont été saisis par des particuliers et par les associations agréées de défense des consommateurs et de défense de la langue française. Les dispositions relatives à la protection du salarié ne paraissent pas rencontrer de difficultés majeures, et elles n’ont donné lieu à aucun litige porté devant les tribunaux. Quelques dossiers sur les offres d’emploi et les documents nécessaires à l’exécution du travail par les salariés sont néanmoins parvenus au ministère du travail. Concernant l’audiovisuel, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) n’a constaté aucune infraction à l’obligation d’emploi du français inscrite dans la loi du 4 août, que ce soit dans les messages publicitaires ou dans les programmes. En outre, une enquête statistique du bureau de vérification de la publicité a montré que contrairement à une idée reçue, les illustrations chantées qui accompagnent les messages publicitaires utilisent à part égale le français (54 %) et les langues étrangères (26 % pour l’anglais, 19 % pour d’autres langues). Conformément aux missions du CSA et au cahier des charges des sociétés nationales de programme, la qualité de la langue bénéficie d’une attention particulière : observation linguistique des programmes, nomination de conseillers qualifiés auprès des chaînes, émissions sur le français. Le premier bilan de l’application des quotas de chansons d’expression française instaurés depuis janvier 1996 pour les radios privées est positif, malgré les réticences exprimées au départ par certaines stations visant les jeunes. Le monde scientifique, économique et technique reste un domaine sensible. La loi a innové en instaurant des obligations minimales pour la présence de notre langue lors de congrès internationaux organisés par des personnes françaises sur le territoire national. L’application de ces dispositions ne bénéficie pas de dispositif de contrôle ni de remontées d’information satisfaisants. La loi impose également aux services publics d’effectuer au moins un résumé en français pour les textes en langue étrangère figurant dans leurs publications. L’enquête annuelle menée auprès des ministères et des grands établissements publics à caractère scientifique montre que cette disposition est bien respectée. Quant aux dispositions relatives aux services publics, le bilan est satisfaisant dans l’ensemble, et certains acteurs publics ont fait preuve de créativité et d’initiative, notamment pour l’élaboration de guides de rédaction administrative, l’introduction dans la formation des agents d’un volet sur les enjeux linguistiques, l’ouverture de nombreux sites des ministères et services publics sur l’Internet. Des efforts particuliers ont pu être observés pour la promotion du plurilinguisme et la sensibilisation du public. Ainsi, certains établissements publics sensibilisés à l’accueil des visiteurs étrangers (transports, musées) mènent une politique dynamique qui va bien au-delà de la loi : la signalétique, les documents d’information, sont établis en beaucoup plus de trois langues, avec des traductions de qualité. Enfin, la loi du 4 août dispose que la connaissance de deux langues étrangères fait partie des objectifs fondamentaux de l’enseignement. La généralisation de l’initiation à une langue vivante à l’école primaire se poursuit. L’obligation d’apprendre une seconde langue vivante en 4e, toutes sections confondues, sera effective à la rentrée 1998, et des actions sont menées par les universités pour que davantage d’étudiants bénéficient de formations à une ou deux langues étrangères. Des formations et des pédagogies spécifiques sont, en outre, mises en place pour l’apprentissage des langues régionales, des langues et cultures d’origine, et pour les établissements d’enseignement à caractère international (sections européennes par exemple). Trois ans après son entrée en vigueur, on constate donc que cette loi est dans l’ensemble bien appliquée. Les difficultés constatées concernent l’emploi du français dans l’informatique, le respect des dispositions de la loi dans les colloques internationaux, notamment dans le domaine scientifique, enfin la rédaction en français des contrats passés par les personnes publiques avec des organismes étrangers ou internationaux, en particulier à la suite d’appels d’offres européens. Le secteur de l’informatique fait l’objet d’une attention particulière de la DGCCRF qui le choisit régulièrement comme thème de ses enquêtes. Pour les colloques internationaux se tenant en France, la délégation générale à la langue française a mis en place, en 1996, un soutien à la traduction simultanée. L’objectif est d’encourager tous les organisateurs à recourir plus souvent à l’interprétation, au-delà des termes de la loi de 1994, qui n’impose la traduction qu’aux services publics. L’existence de ce dispositif modifie très largement l’attitude des organisateurs de colloques à l’égard de l’emploi du français. Pour l’année 1996, la délégation générale à la langue française a soutenu 16 colloques pour un montant de 500 000 francs. Pour l’année 1997, 38 colloques ont été subventionnés pour un montant de 820 000 francs. Enfin, les difficultés rencontrées pour les contrats passés par les personnes publiques avec des organismes étrangers ont donné lieu en 1996 à une modification de la rédaction de l’article 5 de la loi. Cette modification a eu pour objet, dans un souci de sécurité juridique, de préciser le champ d’application de cette disposition dans le domaine des services financiers internationaux offerts par certaines personnes publiques.
(JO du 12-03-1998)
Question :
Recherche
(biologie – primates – élevage – perspectives – Holtzheim)
Le 29 décembre 1997, M. Patrick Leroy attire
l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche
et de la technologie sur l’opportunité du projet de création d’un Centre
national d’élevage de primates pour la recherche, à Holtzheim (Alsace). Outre le
fait que l’article premier du décret interministériel no 87-848 du
19 octobre 1987 relatif à l’expérimentation animale n’est pas appliqué
et qu’il n’est pas scientifiquement prouvé qu’une espèce animale soit le
modèle biologique d’une autre, des échanges de matériel génétique entre espèces
animales et avec l’humain au cours de manipulations ordinaires, génétiques,
chirurgicales ou de vaccins, issus de cultures sur tissus animaux, peuvent aboutir à la
recréation de souches virales mutantes incontrôlables La modernisation et
l’efficience de la recherche en France dans le domaine de la santé publique et de la
sécurité du consommateur demandent des efforts réels car, si notre pays se situe au 4e rang
mondial en ce qui concerne l’investissement budgétaire consacré à la recherche, il
n’est qu’au 14e rang pour ce qui est de la qualité de ses travaux de
recherche. Ne serait-il pas plus pertinent d’adopter une approche scientifique
moderne basée sur l’étude des phénomènes vitaux et des facteurs de leurs
dérèglements ? Ainsi, les fonds destinés au centre d’Holtzheim pourraient
être dévolus pour la création de la première banque française de cellules, tissus et
organes humains pour la recherche fondamentale in vitro associée à la
réhabilitation de
la clinique médicale et de la prévention. Il lui demande donc quelles mesures il
envisage de prendre en la matière.
Réponse :
L’intérêt exceptionnel des primates non humains pour la
recherche biomédicale résulte de leur relation phylogénétique avec l’homme,
relation qui se traduit par de nombreuses similitudes anatomiques, physiologiques,
pathologiques et même comportementales avec ce dernier. Ces caractéristiques
intrinsèques, uniques dans le monde animal, font que les primates sont encore
irremplaçables pour résoudre certains problèmes cruciaux en pathologie humaine. Bien
entendu, conformément à l’article 1er du décret no 87-848
du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux, des études
sur des primates ne sont conduites que lorsqu’il n’existe actuellement aucune
méthode alternative. Pendant de nombreuses années, la majorité de ces primates était
des animaux capturés dans leur biotope naturel et exportés dans les pays utilisateurs.
Outre leur qualité sanitaire médiocre, leur sensibilité voisine aux mêmes agents
pathogènes faisait que ces animaux pouvaient être porteurs de bactéries, de parasites,
mais surtout de virus dangereux pour l’homme. Le projet de création d’un Centre
national d’élevage de primates à Holtzheim
(Bas-Rhin) a pour objectif majeur d’obtenir des animaux sains, au statut sanitaire
parfaitement contrôlé, pour la recherche publique. Cette initiative est encouragée par
la Commission européenne. Pour réaliser les contrôles microbiologiques et sérologiques
indispensables, aussi bien sur les géniteurs importés de pays tiers que sur les animaux
de la colonie d’élevage, un laboratoire d’analyses biologiques spécialisé
dans la pathologie des primates sera également mis en place. Ces mesures permettront
d’éviter tout risque de contamination à l’être humain.
Question :
Enseignement supérieur : personnel
(personnel d’intendance et d’administration – agents comptables –
rémunérations – protocole d’accord Durafour – application)
Le 2 février 1998, M. Jean Rigaud attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des agents comptables d’universités au regard de l’application des accords "Durafour". Les agents comptables d’universités, détachés pour la plupart d’entre eux du ministère des finances, et pour d’autres, du ministère de l’éducation nationale, ne bénéficient pas de l’application des accords "Durafour" qui avait été prévue pour eux le 1er août 1995, contrairement à tous leurs corps d’origine qui ont été reclassés en leur temps. Un projet de décret relatif à la revalorisation de la grille indiciaire correspondant à l’emploi d’agent comptable qui avait reçu l’avis favorable du conseil d’État n’a jamais été publié au Journal officiel. Compte tenu des lourdes responsabilités pécuniaires personnelles de ces agents, qu’une jurisprudence récente vient de renforcer (CNAM), cette carence semble anormale d’autant que l’échelle indiciaire prévue était inférieure à celle des corps principaux d’origine de ces fonctionnaires détachés. Il lui demande s’il envisage de signer rapidement un décret conforme à la réglementation générale des accords "Durafour" et aux pratiques de détachement, pour cette catégorie de personnel. Si cette carence devait perdurer, on peut s’interroger raisonnablement sur l’avenir du niveau de recrutement des agents comptables d’universités, personnels qualifiés choisis en fonction de leur cursus pour gérer les budgets très importants des universités.
Réponse :
Le projet de décret portant statut d’emploi d’agent comptable d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est actuellement en cours de contreseing et sa publication devrait intervenir sans tarder. Ce texte abroge le statut actuel datant du décret du 30 novembre 1970 et fait bénéficier les personnels concernés des revalorisations obtenues dans leurs corps d’origine en application du protocole d’accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. Les emplois d’agents comptables d’EPSCP, désormais accessibles aux attachés principaux d’administration scolaire et universitaire, sont classés en deux groupes dont l’échelonnement indiciaire respectif est compris entre les indices bruts 642 et 966 d’une part, et les indices bruts 642 et 985 d’autre part.
(JO du 16-03-1998)
Question :
Développement des méthodes substitutives
à l’expérimentation animale
Le 29 janvier 1998, M. Philippe Richert attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les méthodes substitutives à l’expérimentation animale. Il semble qu’elles ne soient que trop rarement mises en œuvre en France pour deux raisons essentiellement : le retard de la législation française par rapport aux législations anglaise ou allemande et la mauvaise circulation des informations les concernant. Aussi, il souhaiterait savoir s’il envisage d’intervenir dans un premier temps auprès de son collègue chargé des affaires européennes pour qu’une harmonisation des législations des pays concernés aboutisse, puis quels moyens il envisage de mettre en œuvre pour que les informations relatives aux méthodes substitutives à l’expérimentation animale soient diffusées plus largement et suivies d’application.
Réponse :
Le décret no 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux et ses trois arrêtés d’application du 19 avril 1988, transcrivent en droit français la directive 86/609/CEE du 24 novembre 1986 relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques. L’article premier du décret susmentionné limite la pratique des expériences sur animaux vivants, dans la mesure où seules sont licites celles qui, d’une part revêtent un caractère de nécessité sans que puissent y être utilement substituées d’autres méthodes expérimentales et qui, d’autre part, sont effectuées dans des domaines déterminés. Depuis plusieurs années, un effort scientifique et financier très conséquent a été consacré, aussi bien au niveau national qu’international, au développement et à l’évaluation de méthodes in vitro, alternatives à l’expérimentation animale. Ces méthodes sont déjà employées sur une large échelle dans le criblage et la mise au point de produits, permettant de réduire de façon importante le nombre d’animaux utilisés. Cette réduction peut être évaluée lors des enquêtes sur l’utilisation d’animaux vertébrés à des fins expérimentales réalisées périodiquement par le ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie. La création d’un centre européen pour la validation des méthodes alternatives (ECVAM), implanté au sein de l’institut de l’environnement à Ispra en Italie, est un atout considérable pour accélérer les travaux de validation de ces méthodes. Il s’agit là de la mise en place d’une politique communautaire ambitieuse qui exige des moyens importants visant à coordonner ces travaux de validation, de façon à aboutir aussi rapidement que possible à la reconnaissance de méthodes ou de batteries de méthodes alternatives à l’expérimentation animale, au moins au niveau de l’Union européenne et, de préférence, au niveau international. Dès lors que ces dernières auront été correctement validées, les chercheurs les utiliseront, non seulement parce que la réglementation les y contraint, mais également pour des raisons évidentes de simplification du modèle étudié et de moindre coût. Il n’en demeure pas moins que, dans l’état actuel de nos connaissances, les méthodes alternatives ne peuvent se substituer à l’animal lorsque les études portent sur les réactions d’un organisme entier, dans la mesure où les organismes supérieurs possèdent des mécanismes de régulation et d’interaction (nerveux, cardiovasculaires. endocriniens, métaboliques) entre cellules et organes, multiples et complexes, qu’il est impossible de reproduire dans des systèmes in vitro. C’est la raison pour laquelle l’expérimentation animale ne peut être totalement abolie.
Question :
Rapport de l’Observatoire des sciences et techniques
Le 12 février 1998, M. Serge Mathieu appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les principales conclusions du quatrième rapport biennal de l’Observatoire des sciences et techniques (OST), rendu public en décembre 1997. Ce document, devenu un outil de référence, rassemble un très grand nombre d’indicateurs caractérisant les forces et les faiblesses de la recherche française, sa place au sein de l’ensemble européen et le point de ce dernier dans le monde. Il apparaît notamment que la France est mal classée parmi les vingt premiers pôles scientifiques européens (deux citations) ainsi qu’au niveau des performances en termes de brevets. Parmi les conclusions de ce rapport qui, sans aucun doute, fait l’objet de ses réflexions, figure notamment la constatation que "ces constats conduisent à s’interroger sur la portée des politiques régionales et leur capacité à faire émerger des métropoles de recherche à la dimension de l’Europe". Avec cette constatation, il lui demande de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle s’inspirant de ce rapport.
Réponse :
L’Observatoire des sciences et techniques (OST) est un groupement d’intérêt public auquel le ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie participe. Il a pour mission d’établir des indicateurs quantitatifs dans le domaine de la science et de la technologie. Ceux-ci constituent des instruments utiles, ne serait-ce que parce qu’il est nécessaire de mesurer le résultat des actions passées et de connaître le contexte international avant de construire la politique scientifique de la nation. Mais il n’est pas question, comme semble le suggérer l’honorable parlementaire, de définir les perspectives et les échéances de l’action ministérielle à partir de simples indicateurs. La priorité donnée, dans le budget 1998, à l’emploi scientifique et à la restauration des moyens de fonctionnement des laboratoires est une condition nécessaire au retour d’un esprit d’innovation dans notre pays, qui doit lui permettre d’aborder dans les meilleures conditions possibles la bataille de l’intelligence. Elle dépasse, à l’évidence, la simple prise en compte d’indicateurs chiffrés. Parmi les travaux publiés dans le dernier rapport de l’OST (qui note à juste titre que les indicateurs et, encore plus, l’interprétation qui en est donnée, n’engagent que cet organisme) figurent ceux relatifs aux brevets et aux pôles scientifiques européens. La constatation du nombre trop faible de brevets déposés en France n’est pas neuve. Il convient toutefois de nuancer les explications que l’on peut en donner. Trop longtemps, on a exclusivement parlé d’une inaptitude du système de recherche public à transférer ses résultats. Ne faudrait-il pas, tout autant, s’interroger sur les raisons qui expliquent le peu d’attirance pour la prise de risque et l’innovation de la part de nos entrepreneurs ? L’emploi de jeunes docteurs dans les entreprises, que le Gouvernement entend encourager, devrait faire évoluer les esprits. Quant aux indicateurs sur les pôles scientifiques européens, ils constituent une première tentative de mesure de l’OST dans ce domaine. Il faut saluer cet effort, tout en reconnaissant que les indicateurs choisis sont discutables (nombre total de publications, sans hiérarchisation selon la qualité ou le facteur d’impact). Les résultats publiés ne remettent donc pas en cause la politique d’émergence de pôles de recherche forts, notamment autour des pôles européens. Il faut, bien sûr, que ces "politiques régionales" s’appuient sur une évaluation nationale ou européenne, seule garante de la qualité des actions entreprises.
Question :
Désintérêt pour les herbiers nationaux
Le 12 février 1998, M. Emmanuel Hamel attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l’information parue à la page 12 du quotidien Le Figaro du 12 janvier dernier, selon laquelle "donner aux plantes, savoir l’identifier, la classer, savoir à quelle famille elle appartient pour connaître ses propriétés ou repérer son aire d’extension, c’est le travail des botanistes spécialisés dans la classification et la nomenclature du règne végétal. Les grands herbiers sont leurs outils privilégiés : à la fois banques de données scientifiques et laboratoires de recherche. Aujourd’hui, en France, ils souffrent d’un désintérêt général. L’herbier du laboratoire de phanérogamie du Muséum national d’histoire naturelle, le premier au monde, ainsi que les herbiers de Lyon et de Montpellier se débattent dans de graves difficultés". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette information et si des mesures sont envisagées pour remédier à cette situation, notamment dans l’herbier de Lyon où le professeur de biologie végétale responsable de cet établissement déplore, dans l’article précité, qu’aucun personnel titulaire ne soit affecté à son entretien.
Réponse :
Les herbiers sont des outils indispensables au travail des chercheurs et notre pays en possède plusieurs d’une renommée et d’une richesse internationales. Concernant la situation de ces herbiers et de celui du laboratoire de phanérogamie du Muséum national d’histoire naturelle en particulier, comme de ceux de Lyon et de Montpellier, il est exact qu’une évaluation de leur état est tout à fait nécessaire. C’est dans ce sens qu’a été commandé pour le Muséum national d’histoire naturelle un audit qui doit éclairer le ministère sur les investissements les plus urgents à conduire. Le ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie a inscrit comme une priorité le sauvetage et la valorisation des collections. Des mesures d’urgence sont prévues tant en ce qui concerne les bâtiments qui abritent ces herbiers que leurs conditions techniques de conservation. Les herbiers de Lyon et de Montpellier en seront parmi les premiers bénéficiaires.
Question :
Cessation progressive d’activité et réforme
du régime des retraites dans la fonction publique
Le 25 décembre 1997, M. Roland Huguet appelle l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur la situation de personnes ayant travaillé dans le secteur privé avant leur titularisation dans la fonction publique et ayant demandé la cessation progressive d’activité. Cette demande a été effectuée compte tenu d’un niveau de retraite estimé qui se trouve réduit depuis les réformes du régime général mises en place début 1994. L’engagement irrévocable de prendre sa retraite à soixante ans souscrit dans le cadre de la cessation progressive d’activité apparaît fort rigoureux à leur encontre dans la mesure où il les empêche de poursuivre leur activité pour compléter leurs droits de manière à obtenir le montant de la retraite espéré. En conséquence, il lui demande s’il envisage de prendre des mesures dérogatoires compte tenu des éléments nouveaux apportés par la réforme des retraites du régime général.
Réponse :
Le dispositif de cessation progressive d’activité (CPA), créé par l’ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982, est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et comptant vingt-cinq ans de services en qualité d’agent public, en qualité de titulaire mais aussi comme agent public non titulaire. Les personnes qui bénéficient de ce dispositif effectuent un service à mi-temps rémunéré au taux de 50 % du traitement brut et des primes ou indemnités. À cela s’ajoute une indemnité exceptionnelle de 30 % du traitement brut. Il convient de rappeler que ce dispositif est facultatif. Il n’est pas envisagé de modifier les dispositions statutaires propres aux agents publics pour tenir compte de la modification des règles du régime général de l’assurance vieillesse. Toutefois, l’accord salarial du 10 février 1998, signé avec cinq organisations syndicales représentatives, prévoit un groupe de travail sur l’articulation des dispositifs de cessation progressive d’activité et de congé de fin d’activité.
(JO du 19-03-1998)
Question :
Fonctionnaires et agents publics
(rémunérations – perspectives)
Le 19 janvier 1998, M. Guy Drut demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation s’il est vraiment dans ses intentions d’aboutir à un accord salarial dans la fonction publique. En effet, la loi de finances pour 1998 ne comporte, pour les dépenses de personnel, qu’une provision de 3 milliards de francs, ce qui correspond à une hausse de 0,5 % en année pleine. Il s’étonne donc qu’une négociation commence à peine alors que le budget voté par la représentation nationale, sur proposition du Gouvernement, n’a pas souhaité augmenter les rémunérations de 9 millions de personnels et retraités de plus de 0,5 %. Il souhaite enfin savoir si le Gouvernement, par cette décision, souhaite mettre un terme à la politique contractuelle jusqu’à présent suivie par tous les gouvernements.
Réponse:
Les négociations salariales entamées début janvier 1998 ont abouti à l’accord salarial signé le 10 février 1998 par cinq organisations syndicales représentatives. Par cet accord le Gouvernement renoue en la matière avec la politique contractuelle après une période de plus de quatre années sans négociation. Il est prévu que les traitements et soldes seront majorés de 1,3 en 1998 et en 1999. En outre, 2 points d’indice majoré seront attribués uniformément sur toute la grille des traitements, l’un le 1er avril 1999 et l’autre le 1er novembre 1999. La revalorisation des bas traitements dans la fonction publique est une priorité gouvernementale. Afin qu’aucun traitement indiciaire brut dans la fonction publique ne soit inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), dès le 1er avril 1998, les six premiers échelons des échelles 2 à 5 de la catégorie C seront revalorisés de 1 à 15 points d’indice majoré. L’échelle 1 sera redéfinie à la même date sur la base de 8 échelons au lieu de 11, et de vingt-trois ans de carrière au lieu de vingt-huit ans. Le minimum de traitement correspondra à l’indice majoré 247, montant supérieur au SMIC brut. Cela rendra donc sans objet l’indemnité différentielle instituée par décret no 91-769 du 2 août 1991 et dont la mise en œuvre avait pour résultat la stagnation du traitement alloué en début de carrière aux agents de catégorie C. Les agents contractuels ne pourront être rémunérés sur la base d’un indice inférieur à celui du premier échelon de l’échelle 1. Enfin, le 1er juillet 1998 et le 1er juillet 1999, des points d’indice majorés seront distribués de façon dégressive (4 à 1) jusqu’à l’indice majoré 412. Les ajustements de crédits auxquels pourrait donner lieu la mise en œuvre de l’accord seront opérés dans le respect de l’ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances compte tenu de l’équilibre économique et financier qu’elles définissent.
(JO du 23-03-1998)
Question :
Situation du Centre français sur la population et le développement (CFPED)
Le 5 février 1998, Mme Marie-Claude Beaudeau attire l’attention de M. le secrétaire d’État à la coopération sur la situation du CFPED (Centre français sur la population et le développement), créé par l’INED (Institut national des études démographiques), l’INSEE, l’ORSTOM (Office de recherche scientifique et technique de la France d’outre-mer), l’université Pierre-et-Marie-Curie et l’École des hautes études en sciences sociales, pour conjuguer leurs efforts en matière de recherche, de formation, de coopération avec les pays du Sud dans le domaine de la population et de ses relations avec le développement. Elle lui fait remarquer que le CFPED est géré alternativement par un de ses organismes membres – actuellement l’ORSTOM - ; que son ministère lui verse une contribution et que, avec un budget de 2,5 millions de francs en 1997 contre 16 millions de francs en 1996, le CFPED a dû réduire certaines de ses activités. Compte tenu du maintien des activités de recherche sur les facteurs de la dynamique des populations (santé, famille, fécondité, migrations) de l’Afrique subsaharienne, leurs relations avec les divers aspects du développement économique et social ainsi que les méthodes d’observation et d’analyse appropriées et d’autres études conduites en partenariat étroit avec des organismes du Sud – et l’accueil régulier à Paris des chercheurs des pays du Sud –, il n’estime pas souhaitable et nécessaire de rétablir la subvention du CFPED au niveau de l’année 1996. Elle lui demande quelles mesures il envisage afin d’attribuer un complément de subvention permettant au CFPED de poursuivre l’ensemble de ses études et actions.
Réponse :
À sa création en 1988, le GIS (groupement d’intérêt scientifique) CFPED (Centre français sur la population et le développement) a été chargé de trois missions principales : d’abord, être un observatoire des changements démographiques des pays du tiers monde, mener les recherches nécessaires à la compréhension de ces changements et assurer le fonctionnement d’un centre de documentation de référence ; ensuite, assurer l’accueil et la formation d’étudiants chercheurs en provenance des pays en développement et offrir une structure d’accueil pour les démographes confirmés désirant bénéficier d’une période sabbatique en milieu francophone ; enfin, constituer un réseau de partenaires dans les pays en développement, principalement dans les pays francophones, en vue de mener des activités d’expertise, de formation et de recherche à vocation régionale et de préparer les rendez-vous internationaux (conférences onusiennes, ateliers d’experts). Pour mener à bien ses missions, le CFPED dispose de moyens humains (dix chercheurs et le personnel administratif d’appui) et logistiques fournis par les mandants du GIS (EHESS, INED, INSEE, ORSTOM, Université Paris-6) ainsi que d’un appui institutionnel et sur programme apporté par le ministère délégué à la coopération et à la francophonie. Le montant annuel de cet appui a varié entre 1,2 million de francs et 3,9 millions, maximum atteint en 1996. Ces subventions sont versées à l’ORSTOM, qui assure depuis l’origine la gestion du GIS. La direction du CFPED est par contre tournante et a été assurée successivement par l’ORSTOM, puis l’INED, enfin par l’INSEE depuis 1997. En 1997, le conseil de direction, qui regroupe ses mandants, a recommandé au CFPED de limiter la croissance de son budget, de recentrer ses activités sur la problématique population et développement et de veiller à la complémentarité avec les programmes conduits par les institutions mandantes. Il a aussi recommandé, suivant en cela les conclusions de l’évaluation externe réalisée sous la présidence de M. Anicet Le Pors, conseiller d’État, en 1993, de rechercher une plus grande diversité de financements afin de ne pas dépendre d’une façon aussi importante des crédits du ministère délégué à la coopération, ce qui pourrait nuire à sa capacité d’initiative et à sa visibilité internationale. Le budget adopté pour 1998, qui prend en compte ces recommandations, s’inscrit à 4,2 millions de francs (hors personnel chercheur), dont la moitié sera apportée par le ministère délégué à la coopération et à la francophonie. La convention de subvention correspondante est en cours d’instruction et devrait pouvoir être signée au cours du mois de mars 1998. Les missions appuyées par le ministère délégué restent la veille scientifique et documentaire, avec notamment l’ouverture d’un site Internet francophone sur population et développement, l’accueil et l’encadrement de stagiaires africains et la production de documents originaux sur lesquels pourront s’appuyer les experts de la communauté francophone, en vue notamment de préparer la conférence Le Caire + 5, qui doit se tenir en 1999. Une action particulière envers un public élargi de décideurs de la zone de solidarité prioritaire (parlementaires, responsables politiques locaux, autorités religieuses, journalistes) est demandée. Le ministère délégué à la coopération et à la francophonie entend garantir sur la durée son financement au CFPED tout en fixant sa contribution financière annuelle à environ 50 % du budget de programme de ce partenaire très apprécié. Par contre, le ministère délégué compte faciliter et appuyer les démarches du CFPED pour qu’il puisse obtenir des ressources auprès d’autres bailleurs de fonds, notamment l’Union européenne et le FNUAP.
(JO du 26-03-1998)
Question :
Recherche
(CNRS – personnel – mutations – réglementation)
Le 26 janvier 1998, M. Georges Hage attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des chercheurs du CNRS. La direction du CNRS procède à des mutations arbitraires sans consultation de la commission scientifique et sans négociation avec les représentants du personnel. Ainsi, un éminent mathématicien, directeur de recherche au CNRS, affecté au laboratoire d’informatique de l’École normale supérieure est actuellement en grève de la faim pour protester contre son transfert dans un laboratoire de Jussieu sans qu’aucune raison ni disciplinaire, ni scientifique, puisse être invoquée. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il envisage de prendre afin de garantir les droits fondamentaux des chercheurs du CNRS.
Réponse :
Le problème auquel fait allusion l’honorable parlementaire concerne le cas d’un chercheur qui a fait l’objet, en ce début d’année, d’une mutation dans l’intérêt de la recherche. L’intéressé devait, en effet, être affecté dans un laboratoire développant les mêmes thématiques que les siennes, situé sur le campus voisin de Jussieu, alors que le laboratoire d’informatique de l’École normale supérieure où il effectuait jusqu’à présent ses travaux s’est engagé dans une dynamique de renouvellement de ses thèmes de recherche. Ce mathématicien, jugeant cette mesure arbitraire, a entrepris de protester en choisissant une voie extrême, la grève de la faim, à laquelle il a toutefois mis fin dès le 22 janvier. Le directeur général du CNRS a décidé, par mesure d’apaisement, de suspendre la décision de mutation, laissant le soin à une cellule de médiation (en cours de constitution) de proposer une solution concertée pouvant convenir à l’ensemble des parties concernées. Le règlement négocié attendu de cette affaire, au-delà de la gravité du cas humain qu’elle a révélée, loin de remettre en cause les droits fondamentaux des chercheurs, témoigne au contraire de la volonté et de la capacité de la direction du CNRS à assumer les conséquences des mesures à caractère individuel qu’elle est amenée à prendre dans l’exercice de sa mission.
(JO du 30-03-1998)
Question :
Conditions d’utilisation des contrats emploi-solidarité
Le 27 novembre 1997, M. Michel Sergent attire l’attention de Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité sur les conditions dans lesquelles les CES ont été utilisés depuis le début de l’année. Un dépassement considérable des objectifs est intervenu et implique, sauf à remettre en cause l’ensemble des outils de la globalisation des aides à l’emploi et à la formation, la mise en œuvre d’une politique plus rigoureuse pour le second semestre. Il est donc décidé, et pour maintenir cet objectif, d’accompagner le recentrage de cette mesure sur les publics prioritaires au titre de la politique de l’emploi par une modification des taux de prise en charge par l’État (90 %) des rémunérations et de la cotisation d’assurance chômage. Cependant, cette mesure n’est pas sans conséquence pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la recherche d’un emploi et qui ne font pas partie des publics prioritaires. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part des mesures qu’elle compte prendre pour ces jeunes qui ne pourront être embauchés dans le cadre des emplois-jeunes et qui ne peuvent bénéficier d’un contrat emploi solidarité.
Réponse :
Le contrat emploi solidarité est un dispositif transitoire d’insertion professionnelle destiné aux personnes rencontrant de grandes difficultés pour retrouver un emploi. La réforme des modalités d’intervention du fonds de compensation a pris effet au 1er janvier 1997. Elle a porté les taux de prise en charge par l’État à 90 ou 95 % au maximum. Ces taux qui demeurent extrêmement favorables sont réservés aux publics prioritaires de la politique de l’emploi mais aussi aux jeunes en difficultés particulières, notamment aux jeunes connaissant des situations de chômage récurrent. Les jeunes représentent d’ailleurs 29 % des entrants dans la mesure. Le projet de loi de finances pour 1998 prévoit la conclusion de 500000 conventions, soit un volume d’entrées identique à celui de 1997. Les circulaires de gestion du dispositif, notamment celle en date du 31 décembre 1997, invitent les services départementaux chargés de gérer le dispositif à le recentrer en faveur des personnes qui ne sont pas susceptibles d’occuper un emploi ordinaire ni de suivre une formation qualifiante. Il s’agit de faire bénéficier de cette mesure les publics pour lesquels le CES constitue la seule voie d’accès à l’emploi. Aussi, les jeunes qui ne trouvent pas de solution d’insertion dans les conditions classiques du marché ou par des formules aidées de type contrat initiative-emploi, contrats en alternance, programme "nouveaux services, nouveaux emplois", continueront d’accéder à la mesure CES si leur situation individuelle examinée au cas par cas le justifie.
Question :
Évolution de la situation de la population d’âge actif en France
Le 18 décembre 1997, M. Claude Huriet attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur une récente étude de l’OCDE portant sur la variation entre 1979 et 1995 du nombre de chômeurs, de personnes inactives, d’emplois privés et publics en pourcentage de l’augmentation de la population d’âge actif : de quinze à soixante-quatre ans. Les résultats de cette étude font apparaître qu’à chaque fois que la population d’âge actif a augmenté de 100, les pays du G7, pris dans leur ensemble, ont créé 68 emplois privés, 11 emplois publics, 18 chômeurs et 3 personnes inactives. Il souligne que l’Allemagne a produit : 32 emplois privés, 10 emplois publics, 34 chômeurs et 24 personnes inactives. Quant à la France, elle a, sur cette même période, détruit 18 emplois privés, créé 27 emplois publics, 45 chômeurs et 46 personnes inactives. Le contraste étant pour le moins surprenant, il lui demande en conséquence, pour compléter son information, de lui indiquer, ministère par ministère, l’évolution du nombre de fonctionnaires depuis dix ans.
Réponse :
Les effectifs dans la fonction publique de l’État sont passés de 1,71 million fin 1986 à 1,84 million fin 1996 pour l’ensemble des ministères civils. Il peut être précisé que la création nette de 130000 emplois durant cette période correspond à une hausse de 104000 postes dans l’éducation nationale, 14000 au ministère de la justice, 17000 au ministère de l’intérieur, environ 7000 au ministère de l’équipement, et simultanément à une diminution du nombre d’agents dans certains ministères, dont celui chargé de l’économie et des finances (moins 6000 emplois). On notera que durant ces dix ans les effectifs du ministère de la défense ont nettement décru (moins 58000 postes entre fin 1986 et fin 1994). Un tableau plus complet sera adressé parallèlement à l’honorable parlementaire concernant l’évolution des effectifs.
(JO du 02-04-1998)